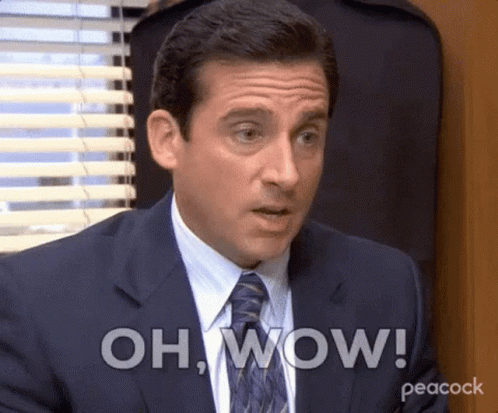Entre engagement technique, transparence radicale et volonté de transformation systémique, Benoit Petit œuvre depuis plusieurs années à rendre le numérique plus mesurable, plus sobre et plus juste. Cofondateur de Hubblo, il développe des outils pour quantifier l’impact environnemental des infrastructures IT. Dans cet entretien, il revient sur son parcours, les défis du secteur et les leviers d’action.
1804580c-07a3-4529-a9c2-f9bc2c119ab6-image.png
Peux-tu revenir sur ton parcours et ce qui t’a conduit à fonder Hubblo ?Benoit : « J’ai commencé par un parcours très classique dans l’IT : j’ai été ingénieur systèmes, réseaux, cloud… pendant une dizaine d’années. Et à un moment, l’absence de considération environnementale dans mon travail contrastait trop avec mes changements de vie et aspirations personnelles, alors j’ai commencé à me poser des questions sur l’impact environnemental de mes choix techniques. J’ai cherché des outils de mesure de l’énergie consommée au niveau des serveurs, et je n’ai rien trouvé qui corresponde à mes besoins. J’ai donc développé un outil libre et open source, Scaphandre, pour répondre à ce besoin. Ce travail m’a progressivement amené à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes objectifs, avec qui nous avons co-fondé Hubblo. L’objectif de Hubblo, c’est d’aider les organisations à réduire l’impact environnemental lié à leurs activités numériques, ce qui implique parfois l’évaluation de ces impacts, toujours en s’appuyant sur des méthodologies robustes et ouvertes. »
Peux-tu nous parler de Scaphandre et de son fonctionnement ?Benoit : « Scaphandre est un agent qui s’installe sur un serveur informatique et permet de mesurer la consommation énergétique d’une partie de ses composants électroniques et des logiciels qui tournent sur ce serveur. Il exploite des interfaces fournies par les fabricants de puces et fonctionne sous GNU/Linux et Windows Server. Il est utilisé aujourd’hui dans plusieurs pays, par des entreprises de plusieurs tailles et avec des cœurs de métier différents. Il est en open- source, donc chacun peut l’adapter, le corriger, l’améliorer. L’idée, c’est de fournir une brique technique fiable et compatible avec les outils de supervision de l’entreprise pour produire de la donnée utile à l’éco-conception. »
Qu’est-ce que propose concrètement Hubblo aujourd’hui ?Benoit : « On accompagne des structures — entreprises, collectivités, hébergeurs — pour leur permettre de faire évoluer leur rapport à la technologie d’un point de vue socio-environnemental, ce qui implique notamment de comprendre leur empreinte environnementale. Pour cela, on développe des outils open source, on contribue à des méthodologies, on produit des données utiles à l’évaluation environnementale, en open-data, et on forme les équipes techniques à les utiliser. Le but, c’est que les gens deviennent autonomes sur ces sujets et soient de plus en plus nombreux à transformer le secteur. »
Pourquoi est-ce si compliqué aujourd’hui d’accéder à des données fiables sur l’impact du numérique ?Benoit : « Il y a une vraie opacité. Les acteurs du cloud et des Datacenters ne donnent que des données globales ou relatives, souvent très orientées communication. Ce manque de transparence rend la comparaison quasi impossible, et empêche de faire des choix éclairés. C’est pour ça qu’on insiste sur la nécessité d’évaluations indépendantes et sur la publication de données ouvertes. Sinon, on ne sortira jamais du greenwashing. La réglementation a bien sûr un rôle central à jouer aujourd’hui et à l’avenir, pour normer et systématiser la transparence. »
Quel est le rôle du collectif Boavizta dans ce paysage ?Benoit : « Boavizta, c’est un collectif qui crée des communs numériques : des bases de données, des outils d’analyse d’impact, des méthodologies. On travaille beaucoup sur l’évaluation environnementale du matériel IT, des datacenters, du cloud, des logiciels… Le collectif regroupe des chercheurs, des ingénieurs, des consultants, des collectivités… L’objectif est que toutes les parties prenantes puissent s’outiller avec les mêmes méthodes et que celles-ci puissent être critiquées, comprises et améliorées. On milite pour une approche ouverte, partagée, rigoureuse. »
Vous travaillez aussi sur une méthodologie sectorielle avec l’ADEME : la PCR Datacenter & Cloud. Quel est l’objectif ?Benoit : « On a contribué à la mise a jour du RCP - Règlement de Catégorie Produit - de l’ADEME, dédiée aux services Cloud et de co-location. L’objectif, c’est d’avoir un cadre reconnu pour évaluer l’impact d’un datacenter ou d’un service cloud, à travers une Analyse de Cycle de Vie (ACV) et des règles d’allocation propres à chaque type de service proposé. Aujourd’hui, chacun fait un peu ce qu’il veut. Si ce RCP devient la norme, une entreprise de services d’hébergement pourra évaluer les impacts de son usage de manière normée, avec des règles communes, en s’appuyant sur les données affichées par le fournisseur. La seconde et dernière version du RCP à date est sur la librairie en ligne de l’ADEME. »
Quel lien fais-tu entre mesure et transformation ?Benoit : « Évaluer, c’est une étape parfois très utile, mais ce n’est qu’un levier. L’enjeu, c’est d’enclencher des transformations profondes : interroger les niveaux de service, se demander si on a vraiment besoin de telle redondance ou de telle disponibilité, mais surtout si l’on souhaite sortir de la seule optimisation et des réductions d’impact à la marge pour entrer dans une démarche réelle de sobriété, questionner le business model, voire entamer sa transformation pour une compatibilité réelle avec les limites planétaires. Dans l’idéal, on commence par là et une fois sur la bonne voie, on optimise pour enlever le superflu. Dans les faits, c’est souvent l’inverse qui a lieu. L’évaluation a un intérêt pour aider la prise de décision stratégique, ou bien à une échelle plus micro pour identifier les optimisations possibles. Ce n’est pas une action positive pour l’environnement en soi. À une échelle plus macro, ça permet de ne pas se faire embrumer par les Big Tech. »
Quel est ton regard sur l’essor de l’intelligence artificielle dans ce contexte ?Benoit : « L’IA, en particulier l’IA générative, vient amplifier tous les travers d’un numérique non soutenable. Ce qui change, ce sont les volumes et la vitesse d’expansion. On parle souvent des impacts environnementaux par inférence ou pour un entraînement d’un modèle particulier, mais c’est une manière pour le secteur de se cacher derrière son petit doigt. Les impacts absolus sont colossaux, la seule consommation d’énergie finale des Datacenters devrait doubler d’ici deux ans et on sait que seule une partie des données sur le sujet sont vraiment disponibles. Google a vu son empreinte carbone prendre 50% sur les 3 dernières années, Microsoft 30% en un an, ce principalement du fait de la construction de nouveaux Datacenters. Et ce ne sont que les impacts que l’on peut évaluer approximativement, la face émergée. Ça ne les empêche pas de se présenter comme les plus “innovants” ou les plus “efficaces” en la matière. Sans parler du fait que les Gafams communiquent principalement sur les émissions liées à l’électricité consommée, tout en comptabilisant les certificats de garantie d’origine qui leur permet d’effacer comptablement les émissions réelles. Le Guardian estime que l’écart entre les émissions annoncées et celles émises si l’on ne compte pas les certificats, est en moyenne une multiplication par 600 entre 2020 et 2023. C’est un jeu de dupes. »
Quel rôle les politiques publiques pourraient-elles jouer selon toi ?Benoit : « Il y a clairement besoin d’un cadre réglementaire plus ambitieux. Des choses se mettent en place, comme la CSRD qui impose un reporting extra-financier, mais c’est encore trop lent côté numérique. Il faut des obligations de transparence (l’Energy Efficiency Directive mise à jour en 2024 en est une prémice), des exigences de données ouvertes et une planification qui prend en compte les conflits d’usage des ressources disponibles. Sans ça, les grandes plateformes continueront à verrouiller l’accès à l’information. Et on restera dans une forme de dépendance technique et politique. »
Quels conseils donnerais-tu à une entreprise qui veut s’engager ?Benoit : « De d’abord actionner tous les leviers évidents qui ne nécessitent pas d’évaluation : augmenter la durée de vie des équipements, identifier les fournisseurs qui peuvent proposer de la location de matériel avec un fort taux de réemploi et de reconditionnement, rejeter l’utilisation systématique des LLMs et privilégier des solutions spécifiques à votre besoin même si ce n’est pas la trend du moment. Actionner le pilier essentiel de l’éco-conception qui consiste à questionner le besoin et l’adéquation entre le réel besoin et la technologie employée. Ensuite, évaluer pour aller plus loin et surtout partager un maximum d’informations pour s’ouvrir la porte de la collaboration avec d’autres acteurs, être le plus transparent possible sur la méthode et les hypothèses des évaluations. Condamner le greenwashing et prendre en compte la dimension systémique et éminemment politique du problème. »
Pour finir, un ouvrage ou une ressource que tu recommanderais ?Benoit : « Oui, un livre que je trouve vraiment éclairant : Aux sources de l’utopie numérique de Fred Turner. Il retrace l’histoire des communautés californiennes des années 60 et montre comment leurs idéaux ont influencé la culture et les infrastructures du numérique actuel, puis comment ces idéaux ont contribué aux modèles économiques que l’on voit chez les entreprises de la Tech aujourd’hui. Ça permet de comprendre que derrière nos outils, il y a des visions du monde — et qu’on gagnerait à les questionner. »

Visuel d’illustration hubblo.org
Source : linkedin.com