[Critique] Mother Land : La cabale dans les bois
-

Alexandre Aja avait déià abordé l’imaginaire démoniaque avec Horns il y a un peu plus de dix ans. Il y revient aujourd’hui avec Mother Land, excellent thriller kafkaïen qu’il est difficile de commenter sans entrer dans certains détails. Vous voilà donc prévenus : il est indispensable d’avoir vu le long métrage avant de lire les lignes qui suivent.
Une mère (Halle Berry, investie à 666 %) et ses deux jumeaux de 12 ans (excellents Anthony B. Jenkins et Percy Daggs IV) survivent isolés au creux d’une épaisse forêt. Leur demeure entièrement bâtie en bois et portant des inscriptions religieuses semble les protéger d’une horrible menace extérieure : une horde de démons qui ont envahi le reste de la planète. Jour après jour, la petite famille s’aventure dans les bois dans l’espoir de trouver de quoi se nourrir. Seule condition : toujours rester connecté à une corde reliée à leur chalet.
À première vue, Mother Land paraît être une réponse directe à Evil Dead et au sous-genre du film de démons popularisé par Sam Raimi à l’aube des années 1980. Dès le premier acte, Aja multiplie les apparitions joliment glauques, une langue fourchue jaillissant du gosier des cadavéreux. On notera au passage l’élégance des maquillages spéciaux d’Adrien Morot, que nous avions eu le plaisir d’interroger à la sortie de The Whale (voir le dossier « Le corps dans tous ses états » ).
Le long-métrage penche également du côté du drame post-apocalyptique, mais troque le mouvement perpétuel de La Route, Mad Max et consorts contre un immobilisme oppressant, symbolisant une absence totale d’espoir extérieur. Deux autres références s’imposent : d’un côté, Le Village de M. Night Shyamalan, dans lequel une communauté recluse essayait d’échapper aux assauts de soi-disant créatures sylvestres ; de l’autre, le magnifique Onibaba de Kaneto Shindô, où deux femmes cachées dans des hautes herbes détroussaient des samouraïs égarés dans un contexte d’empire agonisant. Outre une relecture de son concept et une citation directe lors d’une scène de puits, Aja reprend d’Onibaba une mise en contraste constante entre la subjectivité des protagonistes et l’arrière-plan plus ou moins lointain, renforçant la sensation d’isolement du spectateur et des prétendus héros.

FABLE MOUVANTE
C’est justement là que Mother Land devient passionnant : le point de vue adopté par Aja est aussi ambigu que celui que Paul Verhoeven posait sur Total Recall, et les héros mentionnés plus tôt peuvent progressivement être perçus comme des antagonistes en puissance. Cette lecture évolutive repose sur un scénario extrêmement malin qui appelle une participation active du spectateur, notamment lorsque la mère décrit la décomposition étalée sur plusieurs jours d’un démon ayant pris la forme d’une enfant. S’il ne réinvente pas la roue, le script n’en fait pas moins preuve d’une adresse rare, en cela qu’il comprend parfaitement le cheminement de pensée du spectateur et anticipe ses réflexions avec un sens du timing irréprochable.
Au moment précis où l’on est instinctivement amené à remettre en question la réalité de ce que raconte le personnage de Halle Berry, l’un des enfants se pose en écho de l’autre côté de l’écran et commence à s’opposer aux enseignements de sa mère, installant en une ligne de dialogue un doute sur tout ce qui va suivre. Les enjeux se renouvellent soudainement : en surimpression d’un récit horrifique puisant dans le registre du conte de fées - tout y est, le chapitrage en trois actes, les enfants affamés façon Hänsel et Gretel, la demeure disposant d’un four, les bois épais, la mère envisageant les pires sacrifices et la grand-mère/sorcière menaçant de dévorer les âmes -, Aja et ses scénaristes Kevin Coughlin et Ryan Grassby - auteurs de Mean Dreams, une histoire d’enfants fugueurs, et de The [censored] Tide, un film fantastique insulaire - agencent un drame familial d’une profonde noirceur, abordant à la fois l’héritage des maladies mentales et la contamination de l’extrémisme religieux.

TEMPS MORT
Si ce double discours et ces allers-retours répétés entre deux perceptions contraires du réel fonctionnent aussi bien, c’est parce qu’Alexandre Aja prend le temps de poser en premier acte un univers fantastique de façon très factuelle. Puisque June, le personnage de Halle Berry, est le seul point de repère des enfants comme du public, son postulat est indubitable, comme peuvent l’être les préceptes de toute croyance religieuse héritée de génération en génération. Cette exposition implacable est en soi une réflexion sur le pouvoir de la narration, et sur le principe de suspension d’incrédulité. En s’asseyant dans une salle obscure, le spectateur veut croire à ce qu’on lui raconte, et pose lui-même les conditions nécessaires à l’absorption du récit ; c’est aussi le cas des deux jumeaux du film, dont la prédisposition à suivre les enseignements de leurs parents donnera lieu à des tableaux surnaturels passionnants au cours du dernier acte - des tableaux qui fonctionnent tout aussi bien si l’on privilégie une lecture au premier degré.
Pouvant être vue elle aussi comme une métaphore narrative (elle unit les personnages et fait avancer l’intrigue), la corde fait par ailleurs ressortir l’absence quasi totale d’accessoires technologiques, un choix visuel qui appuie encore le propos d’Aja. Si l’on décide de ne pas croire au bois sacré de la demeure, le personnage de Halle Berry apparaît dès lors comme une geôlière malgré elle, enfermant ses rejetons dans une boucle temporelle sans lendemain. Cette boucle est clairement symbolisée par une horloge ayant perdu tout son sens (la mère relance régulièrement le mécanisme mais ne prend jamais la peine de régler l’heure), ainsi que par un tourne-disque utilisé à de rarissimes occasions. Lorsqu’une chanson désuète sera enfin lue, les jumeaux se mettront à danser la ronde autour du canapé, imitant le mouvement circulaire du vinyle…
À travers son jeu sur la temporalité et sa gestion de l’espace (grâce à la superbe photographie de Maxime Alexandre, l’extérieur et l’intérieur de la maison sont de moins en moins dissociables au fil du récit), Mother Land propose une variation originale autour du thème du survivalisme, une obsession qui gagne en ampleur depuis quelques décennies dans la culture américaine. Glissant un discours politique digne de son génial remake de La colline a des yeux, Aja affirme une nouvelle fois son identité européenne en confrontant ses jeunes personnages à des questions de vie ou de mort, ou à des situations qu’un cinéaste hollywoodien n’assumerait sans doute pas aussi fièrement.
– Par Alexandre Poncet.
– Mad Movies #385 -
patricelg PW Addict DDL Rebelle Windowsien Ciné-Séries Club Membrea répondu à Violence le dernière édition par
@Violence a dit dans [Critique] Mother Land : La cabale dans les bois :
le magnifique Onibaba de Kaneto Shindô
Me souviens pas de l’avoir visionné, à rajouter sur ma liste

-
@patricelg a dit dans [Critique] Mother Land : La cabale dans les bois :
@Violence a dit dans [Critique] Mother Land : La cabale dans les bois :
le magnifique Onibaba de Kaneto Shindô
Me souviens pas de l’avoir visionné, à rajouter sur ma liste

Un chef d’œuvre de la J-horror

-
patricelg PW Addict DDL Rebelle Windowsien Ciné-Séries Club Membrea répondu à Violence le dernière édition par
@Violence a dit dans [Critique] Mother Land : La cabale dans les bois :
Un chef d’œuvre de la J-horror

Trouvé sur darkiworld

-
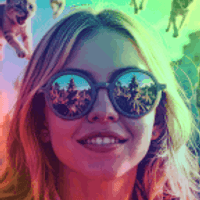 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur

