[Interview] Violent Night - John Leguizamo : « Je ne suis pas un amateur du gore pour le gore »
-

Dans Violent Night comme dans l’entièreté de sa filmographie pléthorique, John Leguizamo ne cesse de démontrer qu’il n’y a pas de seconds rôles ou de rôles mineurs, uniquement des terrains de jeu aux possibilités infinies. Des années de pratique sur les planches peuvent ainsi propulser une figure archétypale comme « Benny Blanco, l’homme du Bronx » dans L’Impasse au firmament des créations légendaires, pour peu que la personne derrière la caméra lui laisse le champ libre.
Aviez-vous vu les films de Tommy Wirkola avant Violent Night ?
Oui, j’avais vu Hansel & Gretel: Witch Hunters et Seven Sisters. J’aime beaucoup ce qu’il fait, j’étais ravi de travailler avec lui parce que c’est un vrai artiste. On pourrait croire que c’est un simple réalisateur de films d’action, qui se concentre surtout sur les séquences physiques, mais non, Tommy est très attaché aux personnages, ça lui tient à cœur de les développer. Et c’est quelque chose qu’on peut sentir dans ses films, y compris celui-là. J’avais lu le script, je savais ce qui se passait, mais je n’ai pas pu m’empêcher d’être ému à la fin.
Ses films ont une touche de mauvais goût très appréciable, qui a tendance à se raréfier aujourd’hui.
C’est vrai, il arrive à dépasser les limites sans trop en faire non plus. Je ne sais pas comment il y arrive, ça vient peut-être de son regard européen sur la culture américaine, c’est sa façon à lui de la commenter.
Quel regard portez-vous sur le cinéma gore ?
C’est compliqué. J’aime le genre quand j’y vois une profondeur, un angle sensible ou réaliste, je ne suis pas un amateur du gore pour le gore. J’adore L’Exorciste, par exemple, pour son approche psychologique et le commentaire sur le catholicisme. J’ai eu la chance de travailler avec le grand George Romero, qui a fait La Nuit des morts-vivants. C’est l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps parce que son point de vue sur le racisme et la guerre du Vietnam résonnait avec l’époque.
Le film que vous avez tourné avec lui, Land of the Dead, parlait lui aussi de son temps avec une longueur d’avance.
Oui, il était très lucide sur la montée du fascisme, sur ces politiciens qui se retranchent derrière des postures droitières, c’était l’apogée de son discours amorcé par La Nuit des morts-vivants. C’était un plaisir de travailler avec lui, et le fait qu’il avait lui aussi des origines latinos faisait sens pour nous deux. C’était un directeur d’acteurs exceptionnel, il avait toujours des suggestions pertinentes, il nous laissait une grande liberté. J’avais l’impression de voir un maître à l’œuvre.
Tommy Wirkola disait qu’il aimait les antagonistes de Violent Night parce qu’ils lui rappelaient les hommes de main des films des années 1980 et 1990.
Il a tout à fait raison, les scénaristes de l’époque savaient qu’ils avaient tout à gagner à développer des bad guys que vous pouviez respecter, et pas ces idiots d’aujourd’hui, ces maniaques égocentriques auxquels vous avez du mal à croire.
Vous avez commencé votre carrière dans les années 1990 et vous étiez catalogués dans les mêmes genres de rôles, une situation que vous mentionnez plusieurs fois dans vos spectacles. Mais vous arriviez toujours à proposer quelque chose qui sortait du lot.
Je n’avais pas le choix, les seuls rôles proposés aux acteurs latino-américains à l’époque, c’était les loubards ou les domestiques, c’était comme ça que Hollywood nous voyait. J’ai saisi toutes les opportunités que je pouvais et j’ai fini par travailler avec des réalisateurs qui comprenaient ce que j’essayais de faire, et qui m’ont aidé à développer ces rôles. Même dans Extravagances (Beeban Kidron, 1995 – NDR), j’ai pu improviser. Dans L’Impasse, je suis allé encore plus loin et Brian de Palma m’a laissé toute la latitude possible – je veux dire, il a fait cinquante prises de mon entrée dans le film, alors qu’il tournait en pellicule ! Mais il se marrait à chaque fois. Il m’a donné une liberté inouïe.

John Leguizamo est l’inoubliable Benny Blanco dans L’Impasse de Brian De Palma face à Al Pacino et Luis Guzmán.La façon dont vous racontez votre scène de confrontation avec Al Pacino, dans votre spectacle Ghetto Klown, est particulièrement savoureuse, ça donne envie de revoir L’Impasse.
Merci beaucoup, le spectacle Ghetto Klown a été compliqué à mettre en œuvre, personne n’avait vraiment raconté son histoire à Hollywood de cette façon, il a fallu trouver le paradigme approprié pour le faire. C’est l’aboutissement de toutes les techniques que j’ai accumulées au fil des années, sur les planches, que ce soit pour les entrées et sorties de scène ou pour l’écriture.
Vous êtes plutôt adepte de l’improvisation que de ce qu’on appelle le method acting, la méthode chère à l’Actors Studio…
Je suis passé par un certain nombre d’écoles, que ce soit le method acting de Lee Strasberg, des techniques plus intellectuelles, physiques ou sensorielles, mais l’improvisation a toujours eu ma préférence. J’ai dû grandir dans les rues new-yorkaises, à une époque où ça impliquait un bon instinct de survie, et ça m’a donné des prédispositions qui me servent encore aujourd’hui.
Qu’est-ce qui vous a poussé à parler de votre expérience personnelle à partir du spectacle Freak ?
C’était avant tout pour donner une voix à l’expérience latine en Amérique. Le racisme envers notre communauté est vraiment intense, et rarement abordé. On représente quasiment un tiers de la population américaine et c’est comme si on était toujours invisibles. Il fallait que je raconte mon histoire pour encourager les artistes latinos à s’exprimer, que les militants et politiciens latinos ne soient plus prostrés, et que les autres communautés nous considèrent comme des alliés dans cette bataille contre le racisme et cette invisibilisation à Hollywood.
Hollywood traverse une période clé en termes de représentation, et vous êtes plus militant que jamais, semble-t-il.
Oh, j’aimerais faire tellement plus ! Il semblerait effectivement que les choses s’améliorent… légèrement. Les Latinos-Américains sont passés de 2 à 3 % des rôles à 5 et 7 %, alors qu’on représente le tiers du box-office et des audiences de streaming à nous seuls… Oui, la situation s’améliore, mais on reste loin du compte à mes yeux.
La vision cynique des choses tendrait à dire que Hollywood ne fait que suivre des tendances qui marchent, et que si les opinions conservatrices à la MAGA l’emportaient, l’industrie retournerait sa veste en deux secondes.
Je ne sais pas, j’ai quand même le sentiment qu’il y a une vraie prise de conscience de la xénophobie latente et qu’elle a été accélérée à la fois par le mouvement Black Lives Matter et la crise du Covid. Et l’industrie essaie de se montrer à la hauteur de ce changement en cours. Je parle à beaucoup d’exécutifs et j’ai l’impression qu’ils veulent participer et porter une approche différente. Hollywood est guidée par la peur, tout le monde a peur de perdre son job, de prendre un risque, et il faut prendre en considération cette culture de la peur, c’est pour ça que le changement n’est pas aussi rapide qu’il le faudrait. Je ne crois pas à une mainmise du mouvement MAGA sur l’industrie, on ne peut pas être un vrai artiste avec leur état d’esprit. Ils n’ont aucune empathie, aucune prise sur la réalité, comment pourraient-ils être satiriques, et commenter quoi que ce soit alors qu’ils sont dans cette dystopie bizarre ?

John Leguizamo discute avec George Romero sur le tournage de Land of the Dead.C’est pour ça qu’ils essaient de créer leur propre écosystème, avec leurs propres sociétés de production.
Oui, ils essaient. Mais ils restent minoritaires, ils représentent à peine 20 % du parti républicain, 5 % de la population américaine.
Vous avez travaillé avec un réalisateur visionnaire sur ces questions, Spike Lee…
Je l’ai vu pas plus tard que la semaine dernière, il donne des cours à l’université de New York et il a organisé une projection de Summer of Sam où il m’a invité avec Michael Imperioli, le scénariste, pour une session de questions/réponses avec des étudiants, c’était génial.
Vous avez déclaré à l’époque que ce tournage avait été une épiphanie pour vous en tant qu’acteur.
Spike Lee évolue à un niveau artistique si élevé que travailler avec lui vous transcende, inévitablement. C’est ce qu’il attend de vous, c’est l’état qu’il vous encourage et vous aide à atteindre, il vous dirige et vous pousse de la façon la plus délicate possible. C’est ma plus grande expérience en tant qu’acteur. Je prenais énormément de risques, j’étais très vulnérable mais je me sentais en sécurité avec lui, je savais qu’il me couvrait, qu’il me donnait tout l’espace disponible. Je n’avais jamais ressenti ça auparavant.
Avant ça, il avait filmé une captation de votre spectacle Freak en 1998.
Il a tout de suite compris ma démarche, on est devenus camarades. Après le tournage, il m’a donné l’opportunité d’assister au montage aux côtés de Barry Alexander Brown, une légende dans le métier, j’ai passé des heures avec lui à apprendre, à voir comment il choisissait les plans. C’est le premier grand cadeau que m’a fait Spike. C’est un réalisateur fondamental dans tous les combats pour la représentation. Et artistiquement, ses films tiennent toujours la route, ils sont toujours vus et continuent d’influencer de nouvelles générations de réalisateurs.
Le film que vous avez réalisé en 2020, Échec et mat, assume clairement l’influence de Lee, dans son énergie notamment.
On a tous les deux grandi à New York, dans la même mixité, on a la même culture, on a des goûts en commun… Mais oui, évidemment, Spike Lee m’a influencé. Je voulais que le film soit sur la corde raide, qu’il sonne vrai. J’ai eu la chance d’avoir un casting incroyable, des premiers rôles latinos au regretté Michael Kenneth Williams, et surtout d’avoir comme matériau cette histoire formidable, que les studios n’ont pas l’habitude de mettre en chantier parce que les récits latinos ne les intéressent pas. Je pense que les chiffres du streaming ne vont pas leur laisser le choix.

John Leguizamo et Adrien Brody dans Summer of Sam de Spike Lee.L’arrivée des plateformes dans le paysage ne vous inquiète pas ?
Bon Dieu non, regardez ce que sont devenus les films, il n’y a plus que des attractions de fête foraine. Ils ne prennent plus en considération la culture, les mouvements artistiques, il n’y a plus d’interrogation sur ce que deviennent les États-Unis, il ne reste plus que des montagnes russes. C’est du cannibalisme de tout ce qui a été fait, avec des remakes à tout va, ça ne me passionne vraiment pas. J’accorde plus d’intérêt à ce qui se passe sur les plateformes de streaming, c’est là désormais que ça se passe en termes de satire, de commentaire, de critique, d’art, tout simplement.
On sort de deux décennies où il se disait que l’avenir de la création se jouait dans les séries…
Je dirais que ça se joue à présent sur les plateformes, c’est là qu’on trouve pour l’instant une liberté créative comparable au cinéma américain des années 1970.
Vous ne trouvez plus de satisfaction dans le cinéma indépendant américain d’aujourd’hui ?
Je ne sais pas… Avant, c’était ce que je préférais, le cinéma indépendant et le théâtre off-Broadway. C’est là qu’on trouvait les récits les plus transgressifs, les plus puissants, c’est là que les marges culturelles bougeaient, les œuvres vous demandaient un effort. Le cinéma indépendant existe toujours, mais le Covid a bouleversé la donne, le public ne se déplace plus comme avant.
Avant Échec et mat, vous avez fait une première tentative derrière la caméra avec le téléfilm Undefeateden 2003. Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ?
C’était très dur, j’ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je tenais le premier rôle, c’était exigeant physiquement parce que ça se passait dans le milieu de la boxe, il fallait respecter des chorégraphies compliquées. J’ai écrit la première version du script, Frank Pugliese est repassé dessus mais il aurait fallu d’autres versions avant d’arriver à un résultat satisfaisant. J’ai appris de mes erreurs ; sur Échec et mat, je n’avais pas le rôle principal, il fallait juste que je progresse sur les stratégies du jeu d’échecs, mais j’avais les consultants idéaux, en l’occurrence les vrais protagonistes de l’histoire, et les jeunes acteurs ont pu assimiler leurs techniques. J’ai retenu une méthode employée par Brian De Palma, Spike Lee et Baz Luhrmann : pendant deux semaines avant le tournage, mettre sur pied un camp d’entraînement dédié à l’apprentissage et aux répétitions. Et ça se sent à l’écran.
Vous avez mûri votre retour derrière la caméra.
J’ai toujours voulu réaliser et ça n’a été qu’accentué par le fait de travailler avec tous ces grands noms, les meilleurs professeurs qu’on puisse imaginer, les Brian De Palma, Tony Scott, Baz Luhrmann, Spike Lee, Brad Furman, Ava DuVernay… J’avais ça en moi et je vais retourner vers la caméra dès que je trouverai le bon sujet. Avant Échec et mat, il y avait des scripts qui m’intéressaient, à propos de l’histoire latino-américaine, mais on me disait : « Hollywood ne fait plus de productions historiques ». C’est ça, ouais. Il y avait toujours des raisons absurdes pour ne pas se lancer dans un tel projet. C’est aussi ce qui m’a poussé à me concentrer sur le théâtre, j’ai écrit des comédies musicales, des pièces, parce que Broadway manque aussi cruellement de représentation latino-américaine. Il n’y a qu’un seul hit en la matière, c’est Hamilton de Lin-Manuel Miranda. C’est un succès absolument énorme, mais c’est aussi le seul de cette communauté. Je veux y retourner et donner aux New-Yorkais ce dont ils ont besoin.

John Leguizamo et Clifton Collins Jr. dans le téléfilm Undefeated qu’il a réalisé lui-même.Avez-vous besoin de continuer à vous produire sur scène en parallèle de votre carrière cinématographique ?
Totalement. Je reste persuadé que les meilleurs acteurs viennent du théâtre. Ralph Fiennes, Al Pacino, Mark Ruffalo, De Niro, Brando… Les plus grands font des allers-retours entre les tournages et la scène parce que c’est le meilleur test possible, ce sont les Jeux olympiques de l’interprétation.
Et où placez-vous le one-man-show dans ces jeux olympiques ?
C’est un défi particulièrement difficile à relever, surtout si vous l’écrivez vous-même. Chaque spectacle me prend cinq ans à concrétiser, pour être sûr que c’est de l’art, que le message est le bon, tout en restant marrant. De mon point de vue, c’est la forme artistique la plus ardue, la plus dure, celle où vous vous retrouvez vraiment à poil devant le public. C’est le travail le plus personnel, celui où vous êtes le plus honnête.
En regardant Ghetto Klown, on a l’impression que vous courez un marathon.
Je confirme, c’est crevant. C’est comme se faire casser la gueule par Mike Tyson tous les soirs. (rires) Je l’ai joué partout aux États-Unis, Miami, Boston, Washington, Chicago, Denver, Seattle, dans tout le Texas, toute la Californie, et même à Londres.
Vous faites partie de la distribution de la série The Power, adaptée du livre génial de Naomi Alderman, pouvez-vous nous en parler un peu ?
Le livre est génial et la série le sera aussi ! J’ai eu la chair de poule devant le teaser. L’histoire est incroyable : que se passerait-il si les jeunes filles, à la puberté, développaient le pouvoir d’infliger des décharges électriques ? Comment réagiraient les hommes ? Comment le pouvoir changerait-il de mains, dans quelles conditions ? Le tournage a été passionnant à tous les niveaux, j’ai hâte que tout le monde puisse voir la série.
Propos recueillis par François Cau.
Merci à Joely Cook, Boris Lobbrecht et Natalie Wire. -
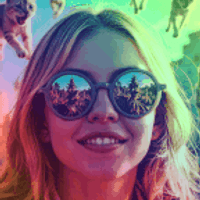 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
-
-
Violent Night est dispo, je me le fais ce soir si tout va bien…

-
-
Film à deux visages, gore et mièvrerie composent un ensemble plutôt bizarre et mal équilibré.
On aurait pu faire un film dans chaque genre avec le script et le résultat aurait sans doute été bien supérieur.
Mais j’ai quand même eu quelques rires francs, le premier dans la scène pipicaca pour ado au début du film quand le père Noël se tire, surtout à cause de l’iconoclastie de la chose.
Edit: Kriss de Noël et calice de je ne sais plus quoi, sans l’accent Québécois, ça fait bizarre.
Quelques violences verbales superflues et mal à propos aussi.Ce film va avoir de la peine à trouver son public.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
S'inscrire Se connecter



 )
)