[Dossier] Les films de bandes : Restons groupés !
-

Dans les villes, dans les campagnes, sur tous les continents, les bandes de jeunes terrorisent les honnêtes gens. Derrière leur bagout de mauvaises filles et de mauvais garçons, des voyous défient l’ordre établi et menacent l’équilibre de vos foyers. Bientôt, si rien n’est fait pour les arrêter, vos propres enfants porteront des vestes en cuir et fumeront des clopes.
Analyse d’un sous-genre de retour dans nos salles avec les sorties imminentes des français Les Rascals et Apaches…
Si les films de gangsters fonctionnent presque systématiquement comme des allégories des sociétés dans lesquelles ils se déroulent, les films de bande traduisent les craintes de ces mêmes sociétés, autant par le dévoiement de la jeunesse que par cet antique déséquilibre entre fascination et répulsion pour tout ce qui vit à la marge. En matière de délinquance juvénile, il y a forcément un petit délice anachronique à confronter notre regard moderne, rompu à la couverture exhaustive de faits divers crapoteux, aux phénomènes qui terrorisaient la bonne société des années 1950.
Le message d’avertissement en entame de L’Équipée sauvage de László Benedek (1953) semble ainsi préparer les esprits sensibles à un florilège d’horreurs commises par le Black Rebel Motorcycle Club, mené par ce marlou de Marlon Brando. Et en effet, les motards gênent la circulation, boivent une bière voire deux, se chicanent en pleine rue : c’en est trop, la foule doit pallier les manquements des forces de l’ordre impuissantes. Il y a surtout à l’œuvre ici une défiance absolue envers l’arrivée de tout corps exogène au sein de la communauté. Mutation des temps, perte des valeurs morales ma bonne dame…
L’œil de 2022 renâcle plus à la vision de Brando embrassant de force une serveuse récalcitrante qu’à celle d’un petit vieux obligé de rabattre son véhicule sur le bas-côté. Il en va de même à la vision de La Fureur de vivre de Nicholas Ray (1955), dont les échos du scandale provoqué par sa sortie semblent bien éloignés de nos angoisses actuelles.
Le dernier roman de James Ellroy, Panique générale, fait du tournage du film la toile de fond de son récit, et de James Dean un personnage secondaire d’indic dont la bisexualité est le signe cristallin de la décadence en cours. Dans le livre comme pour bon nombre de critiques de l’époque, ce projet signe rien moins que le début de la fin de notre monde. Tout conservateur soit-il, Ellroy n’est pas dupe de la réalité du long-métrage et lui invente donc une aura sulfureuse pleine de came, de sexe à plusieurs, de crimes en tous genres, le tout sous l’impulsion anarchiste du fou dangereux Nicholas Ray.

– Mary Murphy et Marlon Brando dans L’Équipée sauvage.Revoir La Fureur de vivre à la suite de cette lecture crée une fracture temporelle et morale totalement disproportionnée, mais permet d’apprécier ce qui a pu remuer les foules de l’époque. Au-delà des rixes au couteau ou au flingue et des défis en voiture, le film marque une volonté de rupture avec le modèle familial traditionnel. Natalie Wood, James Dean et Sal Mineo font mine de rejoindre une bande de loulous mais n’aspirent au fond qu’à reconstituer leur propre cellule familiale ensemble, et à rester ainsi isolés du monde extérieur.
Cette famille choisie évoluera assez logiquement vers la figure, déjà détectable sous le vernis de la censure de l’époque, du ménage à trois, aussi bien chez le Godard de Bande à part que dans le remake Bollywood non officiel de The Rock, Qayamat: City Under Threat, où les militaires mutins sont remplacés par un trouple de terroristes.
SI SI LA FAMILLE
Les films de bande n’hésitent jamais à emprunter à Shakespeare le trope de la romance entre membres de factions rivales pour mieux illustrer des luttes de pouvoir ou des affrontements entre classes sociales. Et pour rester dans le cinéma hindi, la relecture de Roméo et Juliette par Sanjay Leela Bhansali, Ram-Leela, semble un temps fureter du côté du postmodernisme baroque de Baz Luhrmann. Les magnétiques Deepika Padukone et Ranveer Singh se dévorent des yeux et parviennent à renvoyer Claire Danes et Leonardo DiCaprio à leurs chastes minauderies par aquarium interposé.
Puis le film dérape, de gunfights en luttes de territoire, et replie chaque bande sur ses activités illégales et tabou dans le cadre cinématographique étriqué de Bollywood : Ram trafique du porno, la mère de Leela assume la position de cheffe de clan non sans cruauté, tandis qu’un sbire lésé fomente une guerre dans l’ombre. Hasard, coïncidence, l’action se déroule dans l’État du Gujarat, alors administré par le futur premier ministre indien Narendra Modi, déjà accusé d’exacerber voire d’orchestrer les tensions locales.
En matière des romances contrariées, les États-Unis ne sont pas les derniers. Les bandes de West Side Story représentent deux générations d’immigrés dont seule la dernière semble encore croire au rêve américain, constat accentué par Steven Spielberg dans sa version. Dans ce contexte, la passion fulgurante entre Maria et Tony est vouée à l’échec, victime d’éternelles luttes de pouvoir et d’un cycle immuable de la vengeance, avec comme miroir aux alouettes la conquête du territoire.

– Corey Allen et James Deans dans La Fureur de vivre.L’adaptation du roman Outsiders de Susan Eloise Hinton par Francis Ford Coppola (1983) insiste clairement sur les différences de statut social entre les pauvres Greasers et les friqués Socs, pour finalement remiser de côté son histoire d’amour impossible. Il y est à nouveau question de réappropriation de l’Histoire américaine par ses gosses défavorisés, et de famille recomposée en réponse à l’incurie des autorités.
La même année, Coppola tourne une nouvelle adaptation d’un roman signé S.E. Hinton, version absolument négative d’Outsiders. Rusty James répond à la sublime photographie crépusculaire du film précédent par un noir et blanc dense, enveloppant. Toute l’ossature narrative repose cette fois sur l’éclatement d’une famille biologique. Rescapé du casting d’Outsiders, Matt Dillon est écartelé entre son frère loubard, son père alcoolique et un rival joué par le propre neveu du réalisateur, Nicolas Cage.
Le réalisateur du Parrain pourrait être vu comme le cinéaste de la famille par excellence, tant par son œuvre que par sa stature de patriarche ; il témoigne dans Rusty James des frustrations, mesquineries et jalousies entre proches.
Cet esprit de compétitivité déplacé entre frangins irrigue son lointain jumeau Tetro (2009), et Coppola fait mine dans son film suivant, Twixt (2011), de trouver refuge chez une bande de vampires zonards avant de révéler le vrai projet de ce qui reste à ce jour son dernier long-métrage (en attendant son Megalopolis, actuellement en tournage) : exorciser le traumatisme de la mort de son fils Giancarlo.
Peu de cinéastes ont à ce point joué de la frontière ténue entre vécu et fiction, entre fantasme autobiographique et catharsis filmique. Le cadre du film de bande, de par ses projections fantasmatiques d’alternative au système, devient le terreau idéal pour tester les limites personnelles, sociales et politiques.

– Emilio Estevez, Rob Lowe, C. Thomas Howell, Patrick Swayze et Tom Cruise dans The Outsiders.LES FEMMES AU POUVOIR
Et au cœur des années 1960, l’une des limites les plus radicales à franchir n’est autre que le renversement des genres pratiqué par Faster, Pussycat! Kill! Kill! de Russ Meyer. Sous le commandement de la météore Tura Satana, une bande de femmes plantureuses s’amuse à rejouer tous les classiques des gangsters à la petite semaine. Elles font vrombir leurs bolides plus vite que les mâles émasculés qui se mesurent à elles, dominent leurs assaillants, mènent les ébats à la baguette.
Le choc ne vient pas de leur sexualisation par des costumes évocateurs et la caméra concupiscente du réalisateur, mais bien de leur ferme prise en main du récit, éminemment déstabilisante pour les regards effarouchés de l’époque.
Le film est tellement en avance sur son temps que même un projet aussi frondeur que Les Loubardes (The Jezebels/Switchblade Sisters) de Jack Hill, produit dix ans plus tard, ne peut lâcher la bride qu’à mi-parcours, après une exposition douloureuse à souhait. Soit des filles qu’on qualifierait de mauvaise vie, à la colle avec une bande de durs à cuire cons comme des bites menés par un tocard en chef, violeur occasionnel et prompt à s’attaquer à plus fort que lui.
Après une rixe meurtrière, les filles prennent l’ascendant, virent les rétifs, se surnomment les Jezebels et s’en vont quérir l’aide de femmes Black Panthers pour venir à bout de leurs assaillants. Dès 1975, l’intersectionnalité des luttes faisait parler la poudre et les cocktails Molotov. Faster, Pussycat! Kill! Kill! et Les Loubardes ont marqué Quentin Tarantino au point d’inspirer de généreux pans de son Boulevard de la mort, où une bande de filles venge les victimes féminines d’un tueur de la route.
Si Jack Hill revendique son film comme une adaptation très lointaine d’Othello, Les Guerriers de la nuit de Walter Hill (1979) et le roman original de Sol Yurick reprennent les grandes lignes de L’Anabase de Xenophon. Une femme y rejoint le clan au centre de l’intrigue et se montre tout aussi – voire plus – compétente en baston que ses camarades de jeu.

– Les femmes prennent le pouvoir dans Faster, Pussycat! Kill! Kill!.
Le film de bande est le terreau idéal pour faire fonctionner des concepts qui ne peuvent s’exprimer librement, dans un cadre préétabli. C’est là que se jouent à la fois l’avant-garde sociétale, la rencontre entre les grands récits classiques et leur déclinaison contemporaine. Kathryn Bigelow l’a compris dès son vénéneux premier long-métrage, The Loveless (1981), authentique mise à jour de L’Équipée sauvage. La lubricité induite dans l’original par l’uniforme en cuir et l’attitude matoise de Marlon Brando est enfin libérée par Willem Dafoe, tout en animalité hormonale pour sa première apparition à l’écran.
C’est avec Aux frontières de l’aube (1987) que la réalisatrice délivre l’un des fleurons du genre, en lui greffant des éléments fantastiques et en rappelant tout ce qu’il doit au western, avec la précieuse collaboration du scénariste Eric Red.
Le script présente une bande de vampires nomades constituée d’un patriarche, de sa compagne, d’un taré, d’une nouvelle venue et d’un immortel coincé dans un corps d’enfant, sans doute la trouvaille la plus transgressive du lot. Un fermier rejoint de force la famille, n’arrive pas vraiment à s’accoutumer à sa nouvelle condition. La situation empire quand Homer, le jeune garçon de la bande, souhaite recruter la petite sœur de notre héros.
Aux frontières de l’aube est d’une splendeur visuelle de tous les instants dans sa captation sublime des espaces désertés de l’Amérique rurale, dans ses rades poussiéreux ou ses nuits zébrées d’éclairages blafards. Le film jouit de la sauvagerie de sa bande et survit sans encombre au trouble causé par son acteur principal falot. Sa passivité face au mal, du moins jusqu’à ce que sa propre famille soit en danger, fait tout l’intérêt de l’histoire.
Kathryn Bigelow retourne le potentiel mythologique de tous les genres englobés dans ce maelstrom, idéal de film de genre tragique, avant de revenir à un romantisme primitif dans un déchaînement de feu.

– Les vampires prennent (aussi) le pouvoir dans Aux frontières de l’aube.Il semblait impossible de pousser plus avant ces bouleversements dialectiques, et c’est pourtant le miracle insensé accompli par Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico (2017). Des bourgeois oisifs du début du XXe siècle, mettant au même niveau poésie et viol, sont envoyés en redressement sur une île mystérieuse qui les transformera en femmes pirates.
Un pur acte de flibusterie esthétique, d’une beauté incandescente, d’une audace inouïe tant sur le fond que la forme, achevé par l’une des plus belles répliques finales de ce jeune siècle, à destination de ses personnages transfigurés et découvrant leur pouvoir de séduction : « Et surtout, ne soyez jamais vulgaires. ».
CHOOSE LIFE
Impossible d’aborder les subversions propres au genre sans évoquer son 2001, son Barry Lyndon, son Shining : Orange mécanique de Stanley Kubrick. Tout juste sorti du If…. de Lindsay Anderson, Malcolm McDowell incarne le visage d’une jeunesse contestataire, mais cette transposition à l’écran du roman d’Anthony Burgess va propulser son aura au firmament… et dans les abîmes les plus insondables.
Quand bien même le film de Kubrick illustre avec brio les atours dystopiques du roman, avec en première ligne ses déformations langagières et une direction artistique rétrofuturiste au kitsch assumé, la caisse de résonnance sociétale qu’il constitue retourne l’opinion et les instances bienséantes contre lui. À l’instar de ses prédécesseurs les plus médiatisés, Orange mécanique est accusé de dévoyer l’innocente jeunesse et de la pousser au péché.
Le schéma se répète : des criminels se revendiquent du film, ou leurs méfaits rappellent de loin ses scènes emblématiques, et le sort en est jeté. L’éternel débat de l’influence néfaste de la fiction est réglé par l’exemplarité quintessentielle du fait divers, brandie en généralité indiscutable. De fait, l’ultra-violence du film est d’autant plus retorse que la bascule du récit à mi-parcours nous pousse, contre tout bon sens, à développer de l’empathie pour le voyou, cloîtré dans un engrenage de torture psychologique devenue l’image d’Épinal de toute représentation visuelle d’un lavage de cerveau.

– Malcolm McDowell corrige ses Droogs dans Orange mécanique.
Ses inventions formelles, ses brutalités de montage, tout concourt à une jubilation sensorielle, à une expérience viscérale, où la gratuité des événements brouille tout repère moral. Orange mécanique anticipe en outre, avec une prescience troublante, le patron scénaristique des films de bande anglais les plus emblématiques des années à venir : par sa colère et sa radicalité, le meneur pousse sa démarche à l’extrême et finit par s’exclure de lui-même du groupe.
Le constat est amer : tout élan marginal porterait sa fin en lui, avec comme issue le choix entre rentrer dans le rang, finir au fond du gouffre ou trahir ses idéaux et ses amis, quand ce n’est pas tout cela à la fois. C’est le parcours de Carlin, le personnage de Ray Winstone dans Scum d’Alan Clarke (1979), jeté au gnouf après avoir conquis toute la hiérarchie de sa prison juvénile.
C’est aussi celui de Jimmy dans Quadrophenia de Franc Roddam (1979), adaptation désespérée de l’opéra rock des Who sur le mouvement des Mods, ces ados de la classe moyenne, cousins bâtards et lookés des Socs d’Outsiders. Shooté aux amphétamines, remonté contre ses compagnons de route et sa famille, le héros part en quête du Mod ultime et se prend le réel en pleine courge : son modèle est en réalité un groom de palace étoilé, bien propre sur lui. Jimmy lui dérobe sa Vespa et s’en va la jeter du haut d’une falaise, dans un geste certes cathartique, mais un peu vain et mesquin.
Un quart de siècle après Orange mécanique, les héritiers d’Alex et ses Droogs se font surtout du mal à eux-mêmes. Renton, Spud, Sick Boy, Begbie et Tommy, les antihéros du Trainspotting de Danny Boyle, voguent d’un fix d’héro à l’autre sans se soucier des conséquences, peu importe qui souffre, tombe ou crève sur le chemin. Ils forment un groupe dont la soudure dépend du niveau de soulagement opiacé de chacun.
Le roman d’Irvine Welsh plongeait sans masque ni tuba dans la merde crasseuse des marges écossaises, et le film de Boyle n’épargne pas le spectateur de l’époque dans ses multiples scènes-chocs, même si celles-ci ont fatalement perdu de leur pouvoir de sidération au fil des ans. Son projet est ailleurs, comme le confirmera la séquelle tardive du film en 2017 : les deux Trainspotting montrent l’individualisme forcené comme une drogue dure.

– Ewen Bremner, Ewan McGregor, Jonny Lee Miller et Robert Carlyle dans Trainspotting.Dans T2, Renton, Spud, Sick Boy et Begbie ont acté la trahison finale du premier film et vivent chacun de leur côté. Leurs réunions finissent invariablement par tourner court, même une fois les haches de guerre enterrées. Le film joue avec une grande tristesse autour du motif de l’absence, de Tommy, des proches, des principes et idéaux.
Le monologue mythique du premier film, « Choose life », passe du refus du conformisme à son acceptation contrainte, à la résignation face à la marche forcée du monde vers son aliénation absolue, sa quête d’approbation par réseaux sociaux interposés. Une pure réflexion de boomer sur ces sales jeunes et leur Internet, malheureusement corroborée par le destin des films de bandes.
IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
Du côté des États-Unis, le genre mute d’un côté vers le gangstérisme, de l’autre dans les codifications du teen movie qui, dès la fin des années 1980, digère les velléités de rébellion d’un John Hughes pour virer vers l’appel à rentrer dans le rang, au diapason des sitcoms emblématiques des années 1990. Les glissades vers le trash ne seront, au final, que des rejets implicites de tout ce qui sort de la norme.
De Stand by Me en 1986 au premier Ça en 2017 (deux adaptations de Stephen [censored] ; certainement pas un hasard), les films de bande américains marquants regardent vers le passé, comme si les réunions et entraides entre marginaux relevaient forcément d’un autre temps.
Un phénomène similaire peut être observé dans les cinématographies indiennes, avec un repli vers les comédies de groupe d’un côté, et de l’autre une résurgence notable des dacoïts, westerns spécifiquement consacrés aux bandits de grand chemin – en exemple récent, jetez-vous donc toutes affaires cessantes sur le formidable Sonchiriya de Abhishek Chaubey (2019). Bollywood délivre cependant en 2006 une œuvre particulièrement audacieuse (et idéologiquement périlleuse), aussi bien dans son appréhension du genre que dans sa façon de mettre le passé en abyme.

– Alice Patten, Kunal Kapoor, Sharman Joshi, Soha Ali Khan, Siddharth et Aamir Khan dans Rang De Basanti.Rang De Basanti de Rakeysh Omprakash Mehra raconte le désir d’une réalisatrice londonienne de tourner un film basé sur les mémoires de son flic colonial de grand-père, et plus spécifiquement sur son admiration pour des révolutionnaires indépendantistes indiens exécutés sous son commandement. Pour camper ces personnages, elle recrute une bande d’amis insouciants, peu concernés par la situation politique indienne et rêvant d’Amérique. Le groupe est formé de garçons de toutes classes, de tous bords politiques et de toutes religions.
Les deux premiers tiers du film se partagent entre le teen movie aux couleurs criardes et la reconstitution historique en sépia. Dans sa dernière heure, Rang De Basanti bascule dans le drame total avec la mort du plus sérieux de la bande dans un accident d’avion. Ses compères s’engagent dans une manifestation pour dénoncer la responsabilité des autorités dans le crash, le mouvement est réprimé, et les jeunes branleurs finissent par émuler l’esprit de révolte des personnages qu’ils interprètent à l’écran.
C’est là que le film prend un virage pour le moins inattendu : deux amis s’en vont assassiner le ministre de la Défense en pleine rue, puis le groupe prend en otage une station de radio pour contrecarrer l’étouffement de l’affaire par les médias. Ils sont abattus par les forces de l’ordre et leur mort déclenche un mouvement de contestation à travers tout le pays.
Si sa romantisation du terrorisme doit bien évidemment interroger, Rang De Basanti frappe surtout par sa comparaison sans aucune équivoque entre la colonisation britannique et la corruption gouvernementale de l’Inde des années 2000.
Dans toute sa charge politique, sa furie revendicative et le soulagement hautement paradoxal de sa conclusion, Rang De Basanti trouve un double négatif étonnant dans le Nocturama de Bertrand Bonello (2016), film écrit avant les attentats de 2015 et souffrant de fait de l’apolitisme de son regard sur de jeunes terroristes français, d’origine tout aussi multiculturelle que leurs homologues indiens. Leur sort, similaire, convoque à l’inverse un pur sentiment de perte et d’abandon.

– Yana Novikova et Grigoriy Fesenko dans The Tribe.GÉNÉRATIONS SACRIFIÉES
Le genre n’est pas mort pour autant : il surgit là où on ne l’attend pas forcément. D’Ukraine, comme dans le cas du traumatisant The Tribe de Myroslav Slaboshpytskyi (2014), où un adolescent sourd découvre que sa nouvelle école est sous la coupe d’une organisation gouvernée par des pulsions violentes et sexuelles.
D’Islande, avec le raide Beautiful Beings de Guðmundur Arnar Guðmundsson (2022) avec son gosse harcelé qui tourne le dos à sa famille pour se rapprocher de sa bande de bourreaux.
Du Danemark, avec le dérangeant Intet (2022), où la vision du monde d’un groupe de lycéens est radicalement modifiée lorsque l’un de leurs camarades monte dans un arbre et refuse d’en descendre. D’une cruauté hallucinante, le film de Trine Piil Christensen et Seamus McNally scrute les doutes de ses protagonistes, documente leur remise en question avec brio, jouit de les voir créer une œuvre d’art plébiscitée à partir de ce processus… pour finalement tout envoyer valdinguer.
Mais l’exemple récent le plus marquant vient des Pays-Bas avec le stupéfiant We de Rene Eller (2018). À travers une construction scénaristique de plus en plus dévastatrice au fil des différents chapitres et points de vue, le film décrit le quotidien bravache d’une bande d’adolescents apparemment mus par une pure énergie libertaire, libératrice, en réaction à leur train de vie morne.
Petit à petit, les transgressions révèlent leur face sombre, les manipulations trahissent un nihilisme absolu, un égoïsme forcené là où les images élégiaques des débuts, baignées d’un soleil d’heure magique, laissaient augurer d’une échappée belle. Là aussi, l’acte de création artistique est dévitalisé, vidé de son sens au sein de la dynamique de bande.
Tous ces témoignages récents ne rassurent pas franchement sur l’éventualité d’une résistance dans les marges, pourries elles aussi par un individualisme inéluctable. Peut-être qu’un autre film de bande est possible, le film de bande de demain, le film de bande du monde d’après. Mais pour l’instant, les signaux ne sont guère encourageants.
– Par François Cau
Mad Movies #367 -
Moi j’ajouterai “Les guerriers de la nuit (The warriors)” film culte de Walter Hill de 1979…
-
@Violence a dit dans [Dossier] Les films de bandes : Restons groupés ! :
Si Jack Hill revendique son film comme une adaptation très lointaine d’Othello, Les Guerriers de la nuit de Walter Hill (1979) et le roman original de Sol Yurick reprennent les grandes lignes de L’Anabase de Xenophon. Une femme y rejoint le clan au centre de l’intrigue et se montre tout aussi – voire plus – compétente en baston que ses camarades de jeu.
Il est cité dans ce dossier @Nick2

-
Suis une bande de vieux à moi tout seul…

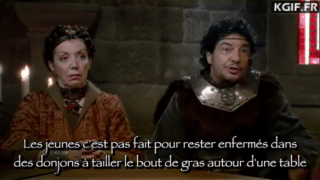
-
Tintintin
-
Moi j’ajouterai “Les guerriers de la nuit (The warriors)” film culte de Walter Hill de 1979…
-
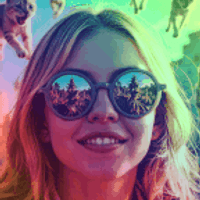 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
S'inscrire Se connecter

