[Carrière] M. Night Shyamalan : Une lumière dans la nuit
-

Interview fleuve très intéressante de M. Night Shyamalan, enjoy

S’il n’est pas le premier long-métrage de M. Night Shyamalan, déjà responsable en 1992 et 1998 des méconnus Praying with Anger et Wide Awake, Sixième sens aura posé les codes et les thématiques d’une carrière absolument passionnante, y compris lors de sorties de route épiques ( Phénomènes ), de compromissions malheureuses ( After Earth ) et d’échecs cuisants au box-office ( Le Dernier maître de l’air , bien meilleur que ne le laisse entendre sa triste réputation).
Huit ans après The Visit, l’auteur virtuose d’ Incassable, Signes, Le Village, Split, et Glass revient dans les pages de MadMovies à l’occasion de la sortie de Knock at the Cabin pour nous aider à décrypter sa riche filmographie…
Comme la plupart de vos films, Knock at the Cabin joue sur les notions de temps et d’espace de façon très minimaliste. Or, le contrôle du temps et de l’espace, c’est la base même du cinéma. Est-ce une intention consciente de votre part ?
C’est fascinant que vous disiez ça, car c’est effectivement quelque chose qui se répète même lorsque je travaille avec d’autres scénaristes, par exemple sur Servant ou Knock at the Cabin. Le genre du thriller est fondé sur une augmentation progressive de la tension et une élévation des enjeux dramatiques. Et ça, ça dépend énormément de la temporalité. Il faut que le public ait conscience qu’une horloge est en train de tourner. On doit comprendre combien de temps il reste aux personnages pour trouver une solution à leur problème. On peut difficilement passer à un mois plus tard sans prévenir. Une semaine, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que ce soit suffisamment bien écrit. Sur le mur derrière vous, je vois l’affiche du film Halloween. Le cœur de l’intrigue se déroule pendant cette nuit bien précise, et même si c’est un concept commercial à la base, ça offre à Carpenter un magnifique compte à rebours. Ce soir-là, les gens sont dans la rue, l’ambiance n’est pas habituelle, et le tueur va sévir jusqu’au petit matin. C’est un modèle de temporalité, et j’adore les restrictions que le genre permet à ce niveau.
C’était votre ambition première avec Knock at the Cabin ?
Clairement. L’intrigue se déroule sur une période très courte. Je voulais contrebalancer l’architecture du raisonnement des héros et la manière dont ils vont gérer le choix qu’on leur impose avec un compte à rebours oppressant. Dès que le film s’ouvre, le public est propulsé dans cette mécanique implacable. C’était mon objectif : je voulais qu’on fonce du début à la fin, jusqu’à ce dernier plan chargé en émotion qui enchaîne sans prévenir sur le générique de fin.
Vos films ne sont pas très longs en général. Vos narrations sont même condensées au maximum, et les éditions vidéo de vos œuvres sont truffées de scènes coupées que d’autres cinéastes auraient sans doute conservées au montage. En postproduction, quand savez-vous que vous avez atteint la forme la plus minimale du film que vous êtes en train de découper ?
J’aimerais vous dire qu’il y a une formule mathématique derrière tout ça, mais c’est plutôt une question de rythme que je ressens au plus profond de moi. La plupart de mes films font à peu près la même durée. Knock at the Cabin est mon script le plus court, et je pensais que ça donnerait mon film le plus court. Je crois que c’est le cas, il doit durer environ 1h40. C’était dû à mon envie de tourner un thriller rapide. Sixième sens, Incassable, Signes et Le Village durent 1h47. Ça ne peut pas être une coïncidence ! Il doit y avoir une équation que je répète inconsciemment derrière la façon dont je raconte mes histoires.
Je presse toujours le montage comme un citron jusqu’à ce que le public ne soit plus en position de penser à ce que je lui montre, mais plutôt en position de le ressentir. Le premier montage de Split durait 3h10, et Glass durait 3h30 ! Au final, ils font chacun environ 2h. Je trouve ce processus vraiment magique, car je découvre une grande partie du film au montage. C’est un art de la juxtaposition assez complexe : quand on monte, 1+1 ne donne pas forcément 2, 1+1 peut donner 3 ! On se rend compte qu’on n’a pas forcément besoin de trois scènes pour arriver à un certain résultat ; on peut en couper une et mettre en relation les deux scènes restantes de façon à arriver au même résultat. C’est à ce moment qu’on comprend quelle séquence peut être coupée sans perdre l’écho narratif ou émotionnel que l’on recherche.
Derrière l’idée de la temporalité, il y a la notion de moment. Vos films sont truffés de moments déterminants pour les personnages, captés dans la longueur en adoptant un point de vue bien précis. Je pense, par exemple, à la scène des escaliers d’Incassable, quand David Dunn porte sa femme dans les bras. Il y a toujours au moins un moment décisif comme celui-ci dans vos longs-métrages.
Je suis d’accord, et il y en a quelques-uns dans Knock at the Cabin. Je pense à un passage en particulier où quelque chose de terrible est en train de se produire, et j’utilise des gros plans extrêmes pour suspendre temps juste avant l’horreur. Je montre des mains, des oreilles, des ustensiles. À ce moment-là, les protagonistes comprennent ce qui les attend, donc il faut tout figer brièvement, en capturant le moindre petit détail.
Vous êtes associés au genre horrifique, mais vous évitez de sombrer dans le gore démonstratif.
En effet.
Comment prévisualisez-vous la violence quand vous travaillez sur un projet comme Knock at the Cabin ?
Je trouve toujours l’insinuation beaucoup plus efficace que la démonstration. J’essaie d’utiliser le cadre comme une fenêtre, afin que la violence intervienne le plus souvent hors champ. Mon rêve ultime, c’est d’amener l’imagination du spectateur à faire le travail. C’est mieux comme ça, à mon avis. Dans Le Village, on ne voit pas le couteau entrer dans la chair, on le voit en sortir. C’est tellement mieux, tellement plus angoissant à mon avis ! Dans Knock at the Cabin, il y a des passages très violents et j’ai essayé d’être très méticuleux dans ma manière d’invoquer l’imagination du public. Ce que je montre et ce que je ne montre pas découlent toujours d’un choix très précis. Le film est classé R aux États-Unis, donc interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, mais c’est surtout dû à la nature de l’histoire et à la tension ambiante.

Bien que votre mise en scène soit minutieuse, vous faites souvent preuve d’un minimalisme extrême. C’est le cas dans Knock at the Cabin, et ça l’était par exemple dans Glass, qui poussait l’exercice aussi loin que possible. Nous pensons particulièrement à une séquence où David Dunn est aspergé d’eau dans sa cellule et se retrouve à terre, à bout de souffle. On ne voit presque rien de tout cela : Bruce Willis fait un mouvement, on se retrouve à l’extérieur du bâtiment face à une citerne qui se met en route, cut sur des gouttes qui tombent de tuyaux fixés au plafond de la cellule… C’est le minimalisme ultime.
J’adore insinuer une action en montrant ce qui se passe juste après, ou aller dehors exactement à l’instant où quelque chose de dramatique est en train de se produire à l’intérieur. L’imagination du spectateur est précieuse et le réalisateur ne devrait pas tout livrer, tout montrer ou tout dire. Tout film devrait être incomplet, car c’est un atout très puissant. On ne doit pas mettre toutes les couleurs disponibles sur la palette, il faut savoir choisir. Avoir un cadre, c’est une chance magnifique : on doit définir le haut, le bas, ce qu’il y a à gauche et à droite, et en tirer parti. J’adore quand un personnage observe quelque chose à l’extérieur du cadre, et que le spectateur doit déduire ce qu’il voit.
Old était une métaphore de la crise du Covid et du confinement. Nous avons nous-mêmes été piégés dans cette plage métaphorique alors que le temps s’écoulait hors champ. Voyez-vous un lien entre Old et Knock at the Cabin ?
Je crois que Knock at the Cabin est plus proche de Signes sur le fond, mais je m’inspire ouvertement des événements qui ont rythmé nos vies ces dix dernières années. C’est donc un film très actuel, qui essaie presque d’exorciser ce que nous pouvons vivre en posant la question : « Une force plus grande que nous est-elle ici à l’œuvre ? ».
Revenons à la gestion de l’espace. Dans Old, vous deviez déplacer des personnages sur une plage déserte sans jamais égarer les spectateurs. Dans Knock at the Cabin, vous nous enfermez dans un décor isolé au milieu des bois. I! faut faire attention, avec pareil contexte, à ne pas répéter les mêmes plans pendant tout le film.
Sur Knock at the Cabin, je crois que nous avons passé quatre mois dans mon bureau à préparer l’ensemble des plans. Il fallait définir le mouvement de chaque séquence et l’emplacement des personnages, en rapport avec leur évolution psychologique. À la page 85, ils ne sont pas au même point qu’à la page 32. Peut-être qu’à la page 32, ils sont dans la perplexité la plus absolue et qu’à la page 85, ils sont désespérés et prêts à faire des choses qu’ils refusaient d’envisager jusqu’alors. Je ne vais pas filmer ces états d’âme de la même façon. Par nature, si on comprend vraiment le point de vue des protagonistes, la mise en scène doit évoluer organiquement. On ne peut pas toujours les cadrer à la même distance, avec les mêmes focales. Ça n’aurait aucun sens au niveau de la dramaturgie.
William Friedkin a dit qu’il évitait de répéter le même plan deux fois dans un film. Si on aborde la mise en scène ainsi, on a vraiment l’impression que l’intrigue avance.
Il a totalement raison, car les personnages ne vivent pas la même émotion deux fois. Même s’ils sont assis dans le même salon, leurs sentiments vont être différents.
Comment répétez-vous avec vos acteurs ?
Comme pour une pièce de théâtre ! Je commence par discuter individuellement avec eux et on échange autour de leur personnage. Ensuite, je fais une lecture avec chaque acteur et j’interprète les autres rôles. On lit un échange de dialogues, on s’arrête pour discuter, on lit un autre échange, on s’arrête de nouveau. Je réponds aux questions, j’essaie d’expliquer pourquoi chaque réplique existe dans le script et comment elle s’intègre dans l’ensemble de la narration. Je veux surtout qu’ils comprennent le projet d’ensemble. Par exemple, s’il y a une réplique maladroite que l’acteur voudrait modifier, je lui explique qu’à ce moment-là, le personnage ne croit pas vraiment ce qu’’il est entrain de dire.
Dans une scène ultérieure, le personnage avouera à demi-mot qu’il n’a jamais pensé ça. C’est apaisant pour un comédien de pouvoir débattre directement avec le scénariste, à mon avis, car il n’y a pas d’ambiguïté possible sur le contenu du manuscrit. Après cette première étape, je forme des groupes de deux ou de trois avec les acteurs principaux et on travaille sur des scènes précises. Ensuite, on fait une lecture complète avec l’ensemble du cast, puis des sessions de répétitions avec tout le monde. Quelques scènes seront très proches du résultat final, d’autres seront largement modifiées pendant le tournage.

Steven Spielberg fait généralement entre trois et cinq prises. David Fincher est plus proche des trente ou quarante. Où vous situez-vous, en moyenne ?
Bonne question. Vu que je ne fais pas beaucoup de coverage, et vu que je veux capter chaque moment du film d’un point de vue bien précis, j’ai tendance à faire beaucoup de prises. Mais pas autant que Fincher, loin de là. J’essaie de viser quelque chose et j’affine au fur et à mesure en verbalisant ce que j’ai perçu dans Ja dernière prise et qui pourrait être encore mieux souligné dans la suivante. Si je vois les comédiens sur Je point d’être emportés par un mouvement de colère et rétropédaler, je vais peut-être leur dire : « C’était exactement ça ! Ne te retiens pas, vas-y ! Ça m’a rappelé telle ou telle chose… ». Là, les yeux de l’acteur s’illuminent et la prise suivante est souvent la bonne. Je dirais que sur Knock at the Cabin, on a pu faire treize, quinze voire dix-huit prises.
C’est un peu de la sculpture. Beaucoup de gens parlent de votre style d’écriture ou de mise en scène, mais votre style de direction d’acteurs est aussi très spécifique. Or, c’est un processus de création très différent de celui de la réalisation ou de la structure narrative.
Je suis d’accord, et Knock at the Cabin m’a offert un terrain de jeu idéal à tous les niveaux. J’avais sept acteurs.
Un nombre magique.
Absolument ! Ils étaient tous bienveillants les uns envers les autres. Tous avaient une couleur différente et ils venaient pour la plupart du théâtre. Quand ils étaient hors champ, ils se donnaient à 100 % pour aider le comédien qui était dans le cadre. Ça fait vraiment la différence quand on doit livrer une performance intense. Tout ceci a aidé à inscrire le film dans une certaine réalité. D’ailleurs, tout le monde pouvait entendre mes directives quand je m’adressais à tel ou tel acteur, et ça a rendu l’équipe très solidaire. C’était très inspirant, sincèrement. Kristen Cui, la petite fille qui joue Wen, n’avait jamais rien tourné auparavant, et elle a découvert le métier au fil des prises de vues.
Elle avait une forte personnalité et j’ai essayé de la retranscrire à l’écran. Elle a beaucoup observé le processus de Jonathan Groff, Ben Aldridge, Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird et des autres, et ça l’a fascinée. Quand elle a pour la première fois laissé libre cours à son émotion face à la caméra, elle a été choquée et surprise. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Je lui ai dit : « Tu as été emportée par la scène, tu as regardé profondément dans les yeux de Jonathan, et tu y as vu de la vraie peur et du vrai désespoir. Ça t’a mue, tu as arrêté de faire semblant, et c’est ce moment que j’ai enregistré ! ».
Comment avez-vous approché le score avec Herdis Stefansdôttir ?
Parfois, il faut faire un saut dans le vide et espérer que ça fonctionne… Et bon sang, ça a vraiment fonctionné avec Herdis. J’avais entendu plusieurs de ses musiques dans d’autres films et on a discuté par Zoom - j’étais aux États-Unis et elle en Islande. Cette collaboration semblait évidente, donc je l’ai engagée très rapidement. Le film est très old school, il est tourné à l’ancienne, et elle a proposé un score tout aussi old school, mais empreint d’une sensibilité moderne. Il y a des accents très classiques mélangés à des sonorités très contemporaines. C’est ce que je recherche quand je travaille sur un film : je veux que mes collaborateurs m’inspirent et m’amènent à me réinventer. Herdis a passé des années à peaufiner son art, et maintenant, elle est prête pour n’importe quel projet. Je dis toujours à mes filles : « Il faut que vous soyez prêtes pour le moment où l’univers vous choisira. Vous ne voulez pas voir ce moment arriver en ayant oublié de travailler auparavant. ».

La musique a toujours eu une place essentielle dans vos films, y compris certains des moins aimés. Comme Le Dernier maître de l’air, dont le score est peut-être le chef-d’œuvre de James Newton Howard. Le morceau Flow Like Water qui accompagne le climax est une merveille.
Je suis d’accord avec vous, c’est tellement beau ! James Newton Howard est vraiment un grand frère pour moi ! Si on vivait dans la même ville, il serait probablement mon meilleur ami. C’est l’homme le plus adorable et le plus élégant que vous puissiez imaginer. Il m’a appris la responsabilité qu’implique le métier de réalisateur et de raconteur d’histoires. Une fois, pendant un dîner, il m’a expliqué que j’avais une responsabilité vis-à-vis du public. Il a dit : « Je suis sérieux. Il faut pratiquer ton art avec honnêteté. ».
Cette leçon m’a accompagné pendant toute ma carrière. Et il a accepté de travailler avec moi quand je n’étais qu’un gamin ! C’était déjà un géant à l’époque, il était bien établi dans le milieu de la musique de film. Je n’en reviens toujours pas. Ma collaboration avec lui est très proche, sur le plan créatif, de celles que j’ai pu avoir avec Herdis ou Trevor Gureckis, le compositeur de Old. Je commence toujours par montrer mon script, puis j’explique les thématiques centrales et je demande une suite d’une quinzaine de minutes basée sur ces idées.
Ainsi, on commence exactement au même niveau. Le compositeur ou la compositrice doit se sentir libre : le nombre de couleurs ou de leitmotivs m’importe peu. Ce qui compte, c’est que ça corresponde aux questions posées par le scénario. Souvent, les thèmes musicaux du score définitif proviennent de cette suite initiale. Je peux dire des choses du genre : « Entre 2min38 et 2min45 dans la suite, il y a un motif incroyable. Tu devrais le développer. En revanche, le motif répété à la cinquième minute, c’est un peu trop ceci ou cela. ». Et parfois, il arrive que tout soit parfait dès le départ. Pour Signes, James Newton Howard a écrit le main tittle du premier coup, en lisant le script. C’était exactement ce que je recherchais!
Votre filmographie est un peu sournoise : vous pitchez souvent un concept précis aux spectateurs, vous leur vendez quelque chose, mais la plupart du temps, ce n’est pas le vrai sujet du film. Par exemple, Le Dernier maître de l’air n’est que superficiellement une adaptation du dessin animé de "Nickelodeon”. Vous parlez surtout du deuil et de la manière dont on est amené à accepter sa propre culpabilité dans une tragédie. Métaphoriquement, le tsunami du climax donne corps aux émotions longtemps réprimées du héros. Ce n’est pas ce que les gens étaient venus voir! Idem pour La Jeune fille de l’eau : le cœur du film, c’est cet instant où Paul Giamatti parle à sa famille décédée à travers le corps inerte de Bryce Dallas Howard.
Oui, c’est exactement ça ! C’était la scène la plus importante pour moi.
Votre meilleur film est peut-être Le Village, qui éclaire la façon dont vous écrivez un twist. D’ailleurs, il nous semble que vous n’écrivez pas de twist : vous écrivez une histoire et vous revenez peu à peu en arrière pour la maquiller en tout autre chose.
Ce qui est primordial, c’est toujours de trouver l’angle que vous voulez appliquer à une histoire. Vous avez une narration linéaire au départ et il faut trouver une manière d’y entrer. Mon prochain film repose sur une idée que j’ai eue… Comment vous en parler sans rien dévoiler ?

Oui s’il vous plaît, évitez !
Disons qu’il y a un concept très intéressant et original, mais on se dirige vers celui-ci d’une façon totalement inédite. Vous n’avez jamais vu une telle histoire racontée sous cet angle, et c’est ça qui rend l’expérience aussi rafraichissante. C’est vraiment une question de perspective, le spectateur doit changer de point de vue sur les événements en même temps que le personnage principal.
Vous êtes réputé pour vos twists ingénieux, et cela peut influer sur la manière dont on appréhende vos films. Tout le monde cherche à comprendre le rebondissement avant qu’il ne se produise. Le premier acte de Split joue, volontairement ou non, avec les fausses pistes : pendant un certain temps, la mise en scène semble suggérer que le personnage d’Anya Taylor-Joy figure parmi les nombreuses personnalités du kidnappeur incarné par James McAvoy…
(rires) C’est intéressant ! C’est une super idée ! Je n’y avais même pas pensé ! (éclat de rire) Je valide. Il faut que je le revoie !
Revenons un peu sur Le Village. C’est l’histoire d’un mensonge inventé par une petite société pour contrôler, en un sens, sa population. Ils se créent même des ennemis car la peur est très pratique pour domestiquer les esprits. Le film est sorti peu après les discours de George W. Bush et Colin Powell sur les soi-disant armes de destruction massive irakiennes. C’est dès lors votre œuvre la plus politique.
Tout le script est parti de cette idée de mensonge. C’est ce que j’ai voulu raconter en premier lieu. C’est un concept assez classique, en réalité : les personnes à la tête d’un pays mentent aux petites gens et inventent une mythologie pour les contrôler. La différence ici, c’est que les menteurs agissent pour ce qu’ils considèrent être le bien du plus grand nombre. La plupart du temps, la notion de contrôle est associée à la cupidité, au pouvoir et la manipulation. Ce n’est pas le cas dans Le Village, et c’est ce qui rend le film aussi bizarre.
On ment pour préserver l’innocence de la jeune génération. On ne parle pas de gain personnel, seulement d’un système de valeurs. On raconte tous à nos enfants des histoires sur le père Noël, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Nous pensons le faire pour les bonnes raisons, nous voulons qu’ils soient heureux, qu’ils se comportent bien, etc. Les personnages du Village ont été écrasés par le monde moderne, ils ont l’opportunité d’élever une génération d’enfants d’une autre façon, mais leur choix a un prix.
Les démons qu’ils pensaient garder à l’extérieur les ont en fait suivis à l’intérieur. Et pourtant, ils choisissent de continuer, parce qu’ils ont vu une promesse en la personne d’Ivy, une jeune femme qui n’aurait peut-être pas été aussi [censored] et innocente sans le fameux mensonge… Le Village a été pensé pour susciter des conversations moralement complexes entre les spectateurs, en montrant un reflet sombre de notre monde.
C’est un film terriblement ambigu, en tout cas loin d’être manichéen. Les personnages portent littéralement le Mal en eux.
En effet, le Mal inhérent à leur espèce n’empêche pas la beauté de ce qu’ils essaient d’entreprendre.
Cette ambiguïté est une constante chez vous. On la retrouve notamment dans Incassable : quand David Dunn ressent l’imminence d’un crime, vous cadrez ses visions à la manière d’une caméra de surveillance. Quand il devient finalement un vigilante et s’apprête à tuer un kidnappeur, la caméra se redresse peu à peu et adopte le point de vue typique d’une caméra de surveillance.
Oui, c’est vrai.

Ce qu’il fait est aussi un crime.
C’est très intéressant que vous ayez lu la séquence ainsi, et cette interprétation fonctionne parfaitement. Mon intention avec cette envolée de caméra était d’adopter le point de vue de l’âme de la mère de famille en train d’observer la mort de son assassin. Il y avait effectivement un lien avec les visions cadrées comme des bandes de caméras de surveillance : dans les deux cas, il y a un jugement vis-à-vis de ce qui est en train de se produire.
Tant qu’on parle d’Incassable, nous avons vu le film en salle dans une version qui n’incluait aucun texte en surimpression des freeze frames sur les visages de Bruce Willis et Samuel L. Jackson. La première fois que nous avons vu ces textes apparaître, c’était dans l’édition DVD…
Ah, c’est vraiment étrange ! Il y avait bien un premier montage sans texte, mais je n’avais pas l’impression qu’il avait été exploité en salles. Peut-être qu’ils ont enlevé le texte pour la sortie en France!
Le résultat était bien meilleur sans le texte, pour être honnête. Les deux personnages étaient soudainement comme figés dans la mythologie d’un comic-book.
C’est ce que je voulais faire au départ.
Vous devriez ressortir le film sous cette forme !
Je vous promets que je vais le revoir et y réfléchir,
Signes est lui aussi un film très ambigu. Le public est amené à croire que les extraterrestres sont maléfiques, mais vous ne le dites jamais clairement. C’est la peur ressentie par les protagonistes qui amène progressivement ce sentiment de paranoïa. Ces créatures sont peut-être simplement désespérées : elles sont même prêtes à s’installer dans un monde majoritairement constitué d’eau, alors que cet élément peut les tuer.
Je les voyais absolument comme des êtres désespérés. C’est intéressant que vous ayez perçu l’intrigue ainsi, parce que c’était exactement comme Ça Que je ressentais les choses. Quand j’aborde la peur, j’évite à tout prix de tomber dans des mécanismes binaires. Ce n’est pas noir ou blanc. Knock at the Cabin en est un nouvel exemple !
Pour finir, parlons du dernier acte de Glass. Pendant tout le film, on entend parier à la télévision d’un grand immeuble ultra moderne où un grand événement est censé se produire, ce qui place dans l’esprit du public un compte à rebours inconscient. Nous n’avons pas l’intention d’utiliser votre réponse dans un titre putaclic du genre « M. Night Shyamnalan a dit ça de Marvel »…
(rires) Merci beaucoup!
… Mais nous voulions tout de même vous poser la question. Le public pense qu’on va aller dans cet immeuble pendant le climax, mais ce n’est pas le cas. Le building reste à l’arrière-plan. Ce bâtiment semble symboliser le MCU et le système des films de super-héros holtywoodiens : vous refusez de les rejoindre.
(ATTENTION SPOILERS) Oui, c’est exactement ça. Produit par Marvel, Glass aurait dû se terminer au sommet de ce gratte-ciel. Des baies vitrées auraient explosé dans tous les sens. J’ai préféré finir ce drame dans un parking ignoble. En coulisse, je n’arrétais pas de dire à tout le monde : « Vous voyez cet immeuble au fond ? C’est là que se trouve Marvel. Nos héros à nous va mourir ci, dans la boue et la crasse. ». En tuant les protagonistes sans réellement faire preuve de goût, j’a voulu dire que cette trilogie ne devait pas atteindre les proportions d’une franchise hollywoodienne.
Cette fin est tellement pessimiste et tragique. La manière dont vous tuez David Dunn, dans une petite flaque d’eau, c’est…
C’est irrespectueux.
Exactement ! On n’est pas censé faire ça.
Malgré tout ce qu’on sait sur lui, malgré son courage et son a*négation, il reste le personnage le plus facile à tuer. Une petite flaque d’eau suffit…
– Propos recueillis par Alexandre Poncet.
– Merci à Boris Lobbrecht.
– Mad Movies #368 -
Oui l’interview ratisse large et est très intéressante @Psyckofox
Ce qui me frappe aussi, c’est que Mad Movies ont de très bonnes analyses des films de manière générale et ça se ressent beaucoup sur cette interview ou Shyamalan valide totalement les analyses et interprétations proposées sur ses films par le magazine.
-
Psyckofox DDL Geek Rebelle Ciné-Séries Club Gamer PW Addicta répondu à Violence le dernière édition par
@Violence a dit dans [Carrière] M. Night Shyamalan : Une lumière dans la nuit :
c’est que Mad Movies ont de très bonnes analyses des films
Effectivement (c’est pas du Écran large
 )
) -
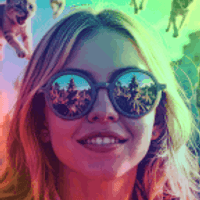 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


