[Interview] Xavier Gens (Farang)
-

Habitué des pages de MadMovies (il nous parlait notamment de Cold Skin dans le numéro 323 et de Gangs of London dans le numéro 343), Xavier Gens n’a pas eu le temps de s’ennuyer ces dernières années. Nous avons retrouvé le cinéaste sur le plateau de son prochain film, un prometteur shark movie produit par Netflix, pour revenir sur les enjeux stylistiques et commerciaux de Farang …
Vous avez commencé à travailler sur Sharks alors que vous tourniez Farang. Toutes proportions gardées, bien sûr, c’est une démarche à la Spielberg !
C’est une grosse comparaison, je suis très flatté, mais c’est vraiment à mon échelle. Même si Farang est mon projet et que je l’ai coécrit, j’ai voulu garder un côté artisanal et me dire : « OK, on enchaîne, on shoote immédiatement autre chose. ». Il faut savoir faire tourner sa propre boutique afin qu’elle reste vivante d’un projet à l’autre.
Les films sont mouvants, c’est comme un magma qui ne demande qu’à exploser. Tant que la lave est encore là, tu continues d’avancer. Tant que le plaisir créatif est là, il ne faut pas le laisser s’échapper et j’ai la chance de pouvoir m’exprimer à travers des projets un peu fous, du moins hors système, hors marché. On parle toujours du « marché » et je déteste ce mot. J’aime faire des propositions atypiques et montrer qu’il y a un espace aujourd’hui pour que des choses différentes puissent exister.
Il y a dix ans, c’était impossible, je n’arrivais pas à trouver ma place, mais aujourd’hui, les geeks ont gagné. On arrive à trouver notre place et on nous demande ! C’est vraiment l’avènement des plateformes qui a provoqué cet appétit pour le genre et la différence.
Un projet a-t-il fait l’effet d’un déclic dans votre carrière récente ?
Oui, Papicha. Je l’ai produit indépendamment avec ma boîte et mes associés Grégoire Gensollen et Patrick André. Ça racontait la jeunesse de ma femme, Mounia Meddour, et je voyais le potentiel de cette histoire en tant que film d’auteur, domaine qui est à l’opposé de mon style habituel. Je regarde autant de cinéma de genre que de cinéma dit « classique », donc je me disais qu’il y avait un vrai film à faire là-dessus.
On a commencé à s’en parler vers 2012. En 2014, Mounia a bouclé une première version du script. Pendant le tournage de Budapest, je lui ai proposé d’aller en Algérie pour faire des repérages et essayer de démarrer la production. On est partis en mode guérilla, tous les deux, on a trouvé des partenaires et le film s’est fait petit à petit. On ne s’attendait pas du tout à la carrière qu’il a pu avoir ensuite. Ç’a été fait avec les tripes, le cœur.
Quand on a terminé Papicha, il n’a pas été acheté tout de suite. On l’a montré au comité de sélection du Festival de Cannes qui nous a invités dans la catégorie Un certain regard. Ça a donné une vraie carrière au long-métrage, on a ensuite gagné des prix au Festival d’Angoulême et plusieurs Césars en 2020…
Il a fait 300.000 entrées alors que c’était un tout petit film « hors marché » que personne n’attendait. Ça a complètement rebattu les cartes.
En parallèle, j’ai fait Gangs of London. Entre Papicha et Gangs…, adoubé par Gareth Evans, j’ai tout de suite vu que je pouvais monter plus facilement mes projets. C’est fou, je l’ai senti du jour au lendemain ! Juste après les César, tout le monde nous appelait car mes projets circulaient déjà depuis un moment dans différentes sociétés. C’est comme si j’étais sous la pile et que soudainement, on m’avait fait passer en haut de cette pile.
C’est là que Farang est né : le scénario était là depuis un moment, mais tout à coup, on a trouvé le financement. Même chose pour d’autres projets qui arrivent derrière, qui font la queue : mon film de requins, un autre en Afrique du Sud que j’aimerais tourner l’année prochaine et un gros film d’action que je suis en train d’écrire avec Jude Poyer et l’une des scénaristes de Gangs of London.
Ce qui est génial, c’est que je n’ai plus à me dire que je vais devoir travailler dans une économie ultra réduite. J’ai fait mes premiers films dans avec peu d’argent, mais j’avais des ambitions inadaptées au budget dont je disposais. Souvent, ça pouvait donc être un peu bancal, maladroit, parce qu’il n’y avait jamais suffisamment de moyens et qu’on y allait quand même.
Aujourd’hui, je peux dire aux producteurs : « Il faut ces moyens-là pour faire ce film de cette manière-là », et j’obtiens généralement ce dont j’ai besoin. Ça donne une liberté et un confort que j’aimerais vraiment conserver, tout en espérant que cela crée un appel d’air pour d’autres réalisateurs.
Farang est une sorte de prototype dans l’industrie aujourd’hui. On pourrait lui reprocher de ressembler par certains aspects aux productions EuropaCorp d’il y a vingt ans, mais ce genre de films peut non seulement ramener du public dans les salles, mais aussi faire revenir le cinéma de genre sur grand écran pas seulement par le biais de l’horreur, mais aussi du thriller. La France a été un grand pays de thrillers, même si ça s’est étiolé au fil du temps.
Le film d’action que je prépare avec Jude est très proche de Classe tous risques de Claude Sautet. Il faut à mon avis renouer avec les racines du polar français et se réapproprier ses codes.

– Xavier Gens (au milieu avec le chapeau), Nassim Lyes (t-shirt blanc) et Jude Poyer (accroupi avec un masque au niveau du cou) posent avec l’équipe des cascadeurs thaïlandais.Vous jouez clairement sur le côté français avec le prologue extrêmement social de Farang. Même le combat d’ouverture se montre très réaliste, du moins jusqu’à la chute. Ce n’est pas le même type de chorégraphie que dans le climax dans l’ascenseur.
Il n’y a qu’un plan annonciateur de ce qui va se passer après et le film bascule à partir de là. Avec Jude Poyer, nous voulions concevoir un combat très réaliste en ne nous permettant qu’un seul gimmick de mise en scène, lorsque les deux personnages tombent ensemble. Ça rappelle les codes du cinéma de Hong Kong.
Oui, il y a un côté Time and Tide.
Exactement. Il fallait infuser cet aspect à ce moment précis. La scène se devait d’être brutale et je voulais vraiment garder la chute jusqu’au bout. Cette mort a un impact sur tout le reste de l’histoire, donc il faut qu’on s’en souvienne.
Il y a tout un cheminement stylistique au fil de Farang.
J’avais envie de faire un film qui mute au fur et à mesure du récit. L’une des références dont on a parlé avec Jude, c’est Adaptation de Spike Jonze, dont le le style évolue constamment. Je voulais exactement ça : partir d’un film français et basculer doucement vers un registre plus coréen ou indonésien, car je m’inspire ouvertement du travail de Gareth et de sa méthode pour chorégraphier les combats.
Farang monte aussi crescendo dans la brutalité : il y a des moments qui annoncent la violence, puis des points de basculement.
La mutation va jusqu’au bout, car on finit par un face-à-face entre Nassim Lyes et Olivier Gourmet, un acteur très typé cinéma d’auteur français, même s’il est de nationalité belge.
Comme on peut le lire dans le livre qui lui est consacré chez TASCHEN, Kubrick disait que lorsqu’il castait des acteurs dans ses films, il se servait de leur bagage cinématographique. Quand on a choisi Olivier Gourmet, pour moi, il y avait tout le bagage des frères Dardenne qui nous faisait entrer dans une réalité sociale crédible. Dans le cinéma de genre français, pendant longtemps, il y a souvent eu des problèmes de jeu.
Parce qu’on essayait justement de faire du genre.
C’est ça. Je me suis affranchi de ces considérations grâce à mes expériences sur Gangs of London et Papicha. Ce dernier, était vraiment un film très français où Mounia, caméra à l’épaule, laissait vivre les situations. Moi, je me prépare tout le temps à fond, mais je l’ai vue se laisser choper par ce qui se passait sur le moment. Elle était tellement décomplexée par rapport à la mise en scène que j’ai décidé de m’inspirer de sa méthode afin de chercher une authenticité, un réalisme dans mes séquences de mise en place en France et en Thaïlande. Ça a aidé à ancrer le genre dans une réalité et le film a pu basculer progressivement par son style sans devenir poussif au niveau des dialogues.
La manière dont j’ai dirigé Nassim rejoint cette idée : je l’ai poussé vers un jeu « auteurisant » – je ne veux surtout pas que ce soit pris comme un gros mot. Il fallait qu’il soit le plus authentique possible et qu’il s’éloigne au maximum des personnages de comédie qu’il avait incarnés avant. Je lui ai dit de revoir Al Pacino dans L’Impasse de Brian De Palma, qui est dans l’é[censored] en permanence.

– Farang se paie quelques effets gore dignes de Lucio Fulci !Et Pacino n’est généralement pas connu pour donner dans l’é[censored…]
Sa prestation est d’autant plus belle. Scarface et L’Impasse, c’est le yin et le yang. Ce sont deux films siamois, qui se répondent. Je voulais amener Nassim vers cette typologie de personnage spécifique. Je lui demandais souvent de reprendre avec une voix plus basse, en s’inspirant d’Eastwood. Pas besoin de monter en volume : less is more.
Quand tu regardes d’autres films français qui ont traité de sujets un peu similaires, tout de suite, on a des grosses cailleras avec des tatouages partout, qui font du rap… On ne peut plus faire ça. Ce genre de facilités propulse le récit dans la caricature, ce qui est, j’insiste, le problème central de notre cinéma de genre.
Quand on essaie d’imiter quelque chose, on le caricature, en bien ou en mal. Parfois ça donne des merveilles comme les deux premiers OSS 117, mais la plupart du temps, on se plante.
Il y a eu des jeux d’acteur très stylisés dans l’Histoire du cinéma de genre français, par exemple celui de Jean Marais dans La Belle et la Bête de Cocteau. C’était bien sûr intégré à un univers visuel et une photographie tout aussi stylisés, mais ça fonctionnait. Il y a encore aujourd’hui aux États-Unis des performances ouvertement expressionnistes, par exemple Nicolas Cage dans la plupart de ses rôles. Mais en France, la stylisation du jeu semble être devenue impossible.
On est très pragmatiques dans le domaine du jeu. Si l’acteur n’y croit pas, nous non plus. Beaucoup de comédiens peuvent regarder le genre de haut. Il faut donc réussir à les amener dans un ancrage beaucoup plus authentique, donc plus auteurisant. Sur Farang, on a toujours été sur un ton premier degré, on a gardé notre identité française ; on n’essayait pas de singer les Américains, ce qui sur Frontière(s) a été mon plus gros défaut.
Mon but sur Farang était surtout de jouer avec la figure du thriller et de l’emmener ailleurs grâce à mon propre bagage et à mon envie de rebooter mon cinéma. Je me suis un peu cherché au fil des années, j’ai exploré des genres, mais je n’ai pas réussi à signer le film où je m’affirmais vraiment. Je pense que Farang est un nouveau premier long : je me réaffirme sur un univers, sur une manière de filmer, sur une façon de trouver mon ton.
Je me souviens d’une interview récente entre Iñárritu et Scorsese : le premier a demandé au second à quel moment il avait réussi à définir son univers. Scorsese a répondu qu’à un moment, on le sent parce qu’on est le plus sincère possible et qu’on ne rougit plus en montrant le film à d’autres.
Quand Iñárritu a fait Birdman, il a appelé Scorsese et lui a dit : « Ça y est, je sais qui je suis. ». Pour lui, Babel ou Amour chiennes appartenaient plus au scénariste qu’à lui. C’est fou, quand même.
Scorsese vient de déclarer qu’il a enfin compris ce qu’il doit faire avec son cinéma, mais qu’à 80 ans, il est presque trop tard.
La vérité de notre travail est là : on doit se chercher et comprendre ce qu’on veut raconter. Je suis un jeune metteur en scène, j’ai démarré à 30 ans et forcément, je me cherchais. On tâtonne, on se trompe, parfois on essaie des trucs qui marchent, d’autres fois, ça ne marche pas du tout, mais on continue d’avancer. Farang est vraiment l’accomplissement d’un apprentissage d’une dizaine d’années.
Un apprentissage demande énormément d’humilité. Nous avons beaucoup échangé au fil des ans, et nous avons toujours eu des discussions très ouvertes concernant vos films, que nous avons parfois aimés, parfois non. Mais il y a toujours eu des débats très sains et des argumentations. On dirait que vous avancez sur le long terme, sans avoir peur d’analyser vos réussites et vos erreurs.
C’est hyper important. Indispensable. Je suis complètement d’accord. Honnêtement, j’espère arriver à la perfection un jour. C’est un peu comme les Compagnons qui ont besoin d’effectuer 10.000 heures de travail avant de pouvoir créer un chef-d’œuvre.
Un jour, j’espère pouvoir faire un chef-d’œuvre. Un. Juste un, à la fin de ma carrière. J’en serais ravi.
Votre projet sur Lapérouse, peut-être ?
Pour moi, c’est le meilleur candidat.
Voilà sans doute pourquoi il ne figure pas dans vos projets imminents, un peu comme si vous reculiez l’échéance pour être sûr d’être totalement prêt.
Il faut savoir attendre pour avoir atteint une maturité suffisante. À 48 ans, j’apprends encore. Quand je vais sur le plateau de Havoc de Gareth Evans en tant que réalisateur de seconde équipe, c’est pour apprendre. Je sais que j’ai plein de choses à découvrir, que je ne connais pas tout.
Ma rencontre avec Gareth et Jude a été absolument fondatrice. Après avoir travaillé avec eux, je ne peux plus bosser autrement. J’ai vu ce qu’il fallait faire, j’ai mis les mains dans le cambouis et ça a scellé une amitié complètement dingue. On entretient une passion commune pour ce genre de cinéma, on cherche l’excellence, donc on veut apprendre en permanence.
Pendant le confinement, on regardait les films d’Imamura pour saisir la substantifique moelle de la narration et de l’émotion et ajouter ce qu’on aime dedans, c’est-à-dire de l’action hard boiled ! (rires)

– La séquence de l’ascenseur, donnant l’illusion d’un plan continu, devrait rester dans les annales du cinéma d’action.La séquence de l’ascenseur est assez hallucinante.
Avec Jude, on voulait créer une nouvelle référence. On a discuté de tous les « beats » narratifs et de l’énergie que la scène devait contenir. La séquence du couloir est une préparation et l’ascenseur doit nous faire mal.
La préparation est même encore un peu plus longue : il y a la scène du quai juste avant. On peut facilement visualiser la direction que prend le climax, d’abord en avant, puis sur le côté avec le couloir et enfin vers le haut avant la rencontre avec le « boss final ». Cela donne une dynamique intéressante au récit.
Et avec la rencontre avec Gourmet, je voulais glisser un clin d’œil à Clarence Boddicker dans RoboCop !
Sage décision. Comme évoqué en début d’interview, vous êtes en train de tourner Sharks alors que nous parlons de Farang. Vous ne vous sentez pas un peu schizophrène ?
Non, c’est même très clair dans mon esprit. Faire la tournée d’un film, c’est un moment un peu marrant, ça reste un plaisir. C’est juste une situation un peu inhabituelle, en particulier en France. Je ne me comparerai jamais au talent d’un Spielberg, mais c’est un vrai modèle, que ce soit en termes d’organisation professionnelle ou dans son style de narration. Il a littéralement le cinéma dans le sang, ça paraît inné chez lui.
J’en parlais récemment avec Michel Hazanavicius. Nous, on va galérer un peu plus que lui avant d’atteindre la pureté d’une séquence, avant de réussir à trouver l’angle de prise de vue nécessaire. C’est une quête perpétuelle. Redémarrer un film aussi rapidement après en avoir achevé un autre, c’est une chance immense à ce niveau.
On peut continuer d’explorer ce qu’il est possible de faire d’un point de vue narratif avec une caméra. Sharks, en plus, est complètement différent de Farang : on est vraiment sur tout autre chose. Et sans que je le veuille vraiment, le film a une teinte Amblin ! On a déjà une heure vingt de montage et on reconnaît cette influence, alors qu’elle n’était pas prévue…
Propos recueillis par Alexandre Poncet
-
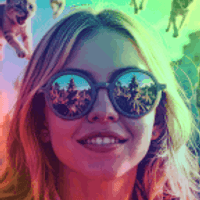 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


