[Dossier] Gore save the screen
-

Les succès surprise de Smile et Barbare ou le passage de Michael Myers à la concasseuse dans Halloween Ends ne sont que les parties émergées de l’iceberg horrifique, actuellement soumis à un changement climatique colossal. Des observateurs aux premières loges reviennent pour nous sur ces mutations structurelles de notre genre de prédilection, à l’aube de lendemains qui chantent… plus ou moins faux.
À l’amorce des années 2010, les fans d’horreur se désespéraient de la tournure du genre, esclave de remakes ineptes, d’une esthétique délavée, de la surenchère débile et de la bêtise réactionnaire dans lesquelles s’enfonçait le torture porn. La société de production Platinum Dunes, spécialisée dans les remises au goût du jour de grands classiques de l’horreur depuis son nouveau Massacre à la tronçonneuse en 2003, voit le filon se tarir avec la contre-performance de son Hitcher, l’accueil glacial de son Vendredi 13 – infoutu de dépasser la barre symbolique des 100 millions de dollars au box-office US – et les torrents de haine dirigés contre son nouveau Freddy.
Le rebond des recettes du septième Saw, après le score décevant de son prédécesseur, se justifiait en partie par la promesse que cette fois-ci, c’était bien la fin, et en 3D mesdames et messieurs. Les tournées en festival du premier The Human Centipede de Tom Six et de A Serbian Film de Srdjan Spasojevic, certes spectaculaires, donnèrent le sentiment à la fois d’une régression de la transgression au stade anal et d’une fin en soi.
Où aller après de telles provocations ? La suite de la carrière de ces agitateurs à la petite semaine nous a donné la réponse : nulle part. En dehors d’une participation décevante à l’anthologie The ABCs of Death en 2012, les seuls projets de Spasojevic sont un deuxième long-métrage annoncé depuis plusieurs années sans signe de développement concret… et un documentaire sur la production de A Serbian Film.
Tom Six a exploité le filon de la chenille humaine dans un second film aussi méta que vomitif et un troisième volet témoignant de son cruel manque d’imagination. Il se prétend victime de censure sur son dernier projet, The Onania Club, consacré à un groupe de femmes uniquement capables de prendre leur pied devant le spectacle de la misère humaine ; la bande-annonce disponible tend plutôt à étayer les rumeurs d’un film gênant au dernier degré.
Frimeur, poseur, mythomane, adepte du buzz à l’emporte-pièce, Tom Six n’est qu’un pur produit de son époque. Son parcours, reflet de la destinée de la saga Saw, a fini par prouver que la seule surenchère ne suffit pas à répondre à la demande. Dans l’attente d’une refonte digne de ce nom, les nouveaux types de formats horrifiques s’engouffrent dans l’appel d’air.

– La mise à mort aussi traumatisante que complaisante de Glenn (Steven Yeun) au début de la saison 7 de The Walking Dead.LES MARCHEURS
Le représentant le plus significatif de cette évolution plurielle naît en 2010 et n’en finit plus de nous infliger son agonie à rallonge : la série The Walking Dead. La première saison explose les records de la chaîne câblée AMC avec des moyennes à 5 millions de spectateurs, la cinquième établit un nouveau jalon pour le câble américain à plus de 17 millions, avant que la propension de la série à tourner en rond ne la ramène à son point de départ.
Par son succès, l’adaptation du comic-book de Robert Kirkman banalise les visions cauchemardesques, soumet le gore à une exposition presque mainstream. Peu importe l’hallucinant chaos artistique et créatif du show ; au contraire, même : au-delà du caractère profondément erratique de son intrigue et de la caractérisation de ses personnages, l’absence de ligne directrice du show finit par refléter avec une acuité troublante le pessimisme et le nihilisme de son époque.
Pour Julien Fonfrède, programmateur de la section Temps 0 au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal, « c’est quelque chose qui résonne avec les deux derniers Halloween de David Gordon Green et la société américaine dans son ensemble, cette idée du “tous pourris” recentrée sur une conception très individualiste : si le Mal est partout, pourquoi n’y cèderais-je pas pour survivre ? On voit des personnages dont on peut reconnaître les valeurs, et soit ils se révèlent monstrueux, soit ils meurent affreusement. C’est mon problème avec le cinéma d’horreur américain, il est devenu hyper réactionnaire. Même un film comme Midsommar témoigne de cette peur de l’étranger, avec ces personnages qui partent en Europe et en ont une vision qui leur appartient. Tout le monde est a priori un monstre. Ce cynisme ne peut que rejaillir en période de crise, je le comprends, mais est-ce que j’ai envie de voir ça ? On tue ton fils, tu vas tuer l’assassin, OK, c’est une logique implacable, mais est-ce que ça fait avancer quoi que ce soit ? L’horreur est revenue, en Amérique, sur des bases très sociétales. Ce sont des films intéressants socialement, mais en revanche, politiquement… »

– L’angoisse diffuse de Barbare.
Il a ainsi été reproché à The Walking Dead son sadisme envers ses personnages, ses penchants à maltraiter le public. Marie Herny, ex-programmatrice du festival punk suisse 2300 Plan 9 et directrice du cinéma ABC à La Chaux-de-Fonds, n’a pas poursuivi son visionnage de la série qu’elle accuse, à raison, d’avoir dénaturé l’œuvre originale, autrement plus fine et puissante. Mais d’un autre côté, elle reconnaît que le show « a peut-être remis certains spectateurs à leur place. L’horreur, c’est de l’horreur. Tu confrontes ton public à son voyeurisme de base, qui peut aussi bien se manifester par le visionnage de documentaires mal fichus sur les tueurs en série que par le fait de ralentir pour voir un accident sur l’autoroute. Je trouve qu’il peut être intéressant de responsabiliser le public par rapport à ce qu’il regarde. Tu ne peux pas bouffer ce genre de choses et les digérer sans encombre sans te poser un minimum de questions. Le cinéma d’horreur a toujours été un baromètre de la société et je pense que c’est pour ça que j’ai décroché pendant un bon moment du cinéma horrifique américain. Soit ça ressemblait à un règlement de comptes, soit c’était vraiment fascisant. Même quand les films attaquent Trump, c’est dans la stupidité, sans finesse scénaristique. »
LES PROMESSES DE L’OMBRE
La série morte-vivante s’est retrouvée tête de gondole dès son arrivée sur Netflix. Dans son sillage, la plateforme au « N » rouge et sa principale concurrente, Prime Vidéo, ont senti une manne, une demande, un besoin d’horreur, sans pour autant proposer d’éditorialisation ad hoc.
Pour Julien Fonfrède, « ces plateformes sont très lisses, on a l’impression que c’est là que l’avenir du genre pourrait se jouer, et en même temps, ils prennent tout et n’importe quoi dans l’unique logique de créer un catalogue. Et ça dessert le genre. Même dans les années 1970, il y avait beaucoup de saloperies, mais aussi beaucoup de productions cinématographiques qui pouvaient se retrouver au premier plan et inspirer. Il nous manque des références à mettre sur un piédestal pour sortir de la consommation à la chaîne. »
Il faut reconnaître à ces deux gros pourvoyeurs de contenus le mérite de proposer des cinématographies peu connues, dans des copies de qualité et parfois sous-titrées en français. Encore faut-il savoir se jouer de l’algorithme de recommandations et chercher dans des recoins savamment dissimulés.
Aurélien Zimmermann, programmateur pour la plateforme de SVOD Shadowz, joue fair-play et ne jette pas le bébé mutant avec l’eau du bain. « Il y a eu cette impression que les plateformes généralistes ne savaient pas comment aborder le genre, mais qu’elles avaient tout de même conscience qu’il y avait un public, des communautés, des festivals. Du coup, elles ont tapé large, elles ont produit des films de qualité variable, mais elles ont su offrir des opportunités à des cinéastes comme Gareth Evans avec son Bon apôtre, un film qu’on n’aurait pas pu voir autrement et que j’adore. »
Le projet Shadowz s’est justement monté sur la juste intuition qu’il existait un public pour ce genre d’initiatives. Le crowdfunding de lancement récolte 300 % de la somme demandée, les premiers partenariats s’établissent dans la foulée, un catalogue de lancement d’une centaine de titres se monte sans obstacle majeur, tout est prêt pour l’inauguration le 13 mars 2020… soit une semaine avant le premier confinement.

– Le déchaînement sadique de The Sadness.En amont de ce coup d’arrêt de l’exploitation cinématographique, au gré duquel les plateformes vont prendre un ascendant dévastateur sur les salles obscures, le cinéma d’horreur sort d’une décennie de révolution tranquille. La première moitié des années 2010 joue sur ses acquis, produit toujours du torture porn et du found footage à la chaîne avec des fortunes très diverses. Les productions bas de gamme et cyniques parviennent parfois en salles, quelques auteurs émergent sans parvenir à sortir des circuits fermés des festivals spécialisés. Arrive alors l’année 2017 et, avec elle, la vraie révolution que le genre attendait.
L’ASCENSEUR SOCIAL
Cette année marque l’émergence des productions A24, avec coup sur coup It Comes at Night de Trey Edward Shults, Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell et A Ghost Story de David Lowery. Sous cette impulsion, et avec le succès raz-de-marée du Get Out de Jordan Peele (254 millions à travers le monde), se répand le label croquignolet de l’« elevated horror ». Ouf, le genre redevient fréquentable, il existe désormais une certification qualitative susceptible de le déghettoïser.
Julien Fonfrède ne cède pas aux sirènes bienséantes : « Ce sont vraiment des termes pensés en laboratoire pour pouvoir vendre des produits, ou alors ça vient d’universitaires américains qui enseignent le cinéma de genre, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On s’attend à quelque chose de plus intelligent et moins axé sur le divertissement, alors qu’on a tous grandi devant des films qui proposaient ces deux tendances sans les forcer. Je viens du cinéma asiatique, de Hong Kong particulièrement, de cette culture où les notions de cinéma d’auteur et de cinéma commercial n’existent pas. Les films devaient faire de l’argent, point, on trouvait souvent ces deux aspects en même temps et on ne se posait pas ce genre de questions. »
Marie Herny abonde, même si elle reconnaît que cette nouvelle catégorisation lui permet d’ouvrir les portes de sa salle Art et Essai au cinéma horrifique. « Grâce à la nouvelle version de Nia DaCosta, j’ai pu programmer son Candyman et celui de Bernard Rose. Je peux faire des cycles John Carpenter. Le spectateur peut se mettre à apprécier ce cinéma sans passer pour une espèce de gros beauf sans vraie connaissance cinématographique. C’est aussi une caution, mais ça peut virer à la récupération. Je n’aime pas spécialement Titane, mais j’étais gênée pour Julia Ducournau à Cannes, elle est devenue l’étendard de la cause féministe alors qu’elle n’a pas forcément envie qu’on réduise son travail à ça : “Allez, t’es une femme, sois intelligente, fais-nous un discours politique.” »
Côté biftons, 2017 est l’année du carton atomique du Ça d’Andy Muschietti ((701 millions de recettes mondiales), retour à une horreur premier degré, frontale et dérangeante en dépit de partis pris d’adaptation contestable par rapport aux livres de Stephen [censored] (sur le changement d’époque, en particulier). Dans sa foulée, les transpositions de l’auteur du Maine repartent de plus belle et les figures classiques du panthéon horrifique, comme Michael Myers, peuvent s’offrir une deuxième jeunesse plus rentre-dedans. Mais le monstre le plus mémorable de l’année n’est autre que Harvey Weinstein.

– Le coréen Project Wolf Hunting de Kim Hong-sun.LE WOKISME EN QUESTION
Le producteur de Miramax devient le catalyseur du mouvement #metoo, qui trouve là sa montagne à franchir pour faire porter son discours. Avant la réelle mise en cause de Weinstein en 2017, le cinéma d’horreur bruissait déjà de revendications progressistes et particulièrement féministes. Il y a eu, en amont du phénomène, toute une vague de films où des femmes traquées se retournaient contre leurs agresseurs. Une nouvelle génération de réalisatrices a tenté de faire ses premières armes en se réappropriant des genres typiquement masculins, comme le rape and revenge.
L’affaire Harvey Weinstein éclate moins d’un an après l’élection de Donald Trump, en pleine polarisation des débats publics : les langues se délient, les républicains se réjouissent de voir les élites du divertissement de masse, étiquetées démocrates, s’empêtrer dans leurs contradictions. D’autres affaires éclatent, l’industrie hollywoodienne passe en mode défensif et se livre à des entreprises de réécriture aussi maladroites qu’opportunistes.
Les films Baywatch : alerte à Malibu et Charlie’s Angels se targuent d’avoir gommé toutes leurs composantes problématiques. Le remake de Black Christmas cuvée 2019 vire au cas d’école. « Ce sont des films qu’on voit venir de loin en termes de thématiques, de gros blocs carrés de vengeance féminine » assène Julien Fonfrède. « Ils ont correspondu à un air du temps dont l’apogée a été le premier Halloween de David Gordon Green, avec son approche du personnage de Laurie Strode. »
Quand bien même ces thématiques étaient déjà bien implantées dans le genre, les films prenant à bras le corps les sujets sociétaux sont particulièrement scrutés et mis en avant dans l’ère post #metoo. Se développe le sentiment d’une férule idéologique écrasante, un rouleau compresseur de bonne conscience contre lequel personne ne peut rien.
« Je prends le terme “wokisme” avec des pincettes » tempère Aurélien Zimmermann. « Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise chose. Même si le terme est connoté négativement, il traduit un éveil des consciences sur des sujets qu’on n’osait pas aborder, c’est important. Après, il peut y avoir du forcing, on peut sentir qu’une œuvre est modifiée, de façon hypocrite, pour coller à un effet de mode. Mais je suis ravi que l’horreur parle de sujets naguère laissés de côté, comme la transidentité, le féminisme. Sur Shadowz, on propose des films comme Lucky ou Violation, deux œuvres qui implantent leur discours féministe dans leurs mécanismes de narration et en font le spectre d’une mise en images de l’horreur, et le résultat est génial, en plus d’être pertinent. L’art évolue constamment dans ses méthodes, ses façons de raconter des histoires, c’est une évolution logique de la culture de parler de sujets plus actuels. »

– Le mexicain Huesera de Michelle Garza Cervera.Si Marie Herny ne mâche pas ses mots sur le sujet, elle n’en reste pas moins alerte sur les éventuelles dérives et solutions de facilité. « Ce genre de craintes et d’insécurité provient d’hommes qui se sentent attaqués d’entrée de jeu, et plutôt que de se remettre en question, de voir ce qu’il pourrait y avoir d’intéressant là-dedans, ils crient au scandale. Et pour autant, je n’aime pas du tout le principe woke d’uniformiser une pensée, c’est un danger quel que soit le côté où tu te trouves. Quelque part, ça revient à enfermer les femmes dans un autre rôle, celui de porte-parole, c’est contre-productif, c’est une façon de cloisonner encore plus la créativité des réalisatrices. C’est comme ce principe très sarkozyste de discrimination positive de programmer 50 % de femmes, ça m’emmerde royalement, ça ne sert pas les femmes si les productions ne sont pas bonnes. On arrive à un moment où le cinéma d’horreur est moins fermé qu’avant, il est plus facile pour des créatrices de mener leur projet à bien, il faut que ça se fasse naturellement. »
GORE DE COMBAT
Au regard des scores de 2017, le succès américain du Barbare de Zach Cregger (45 millions au box-office, soit dix fois son budget) peut sembler petit bras, mais ce serait nier la réalité bien plus complexe du marché depuis la crise sanitaire. Surtout, ce succès a insufflé une bonne dose d’optimisme quant à l’assimilation de thématiques progressistes sans pour autant se vautrer dans l’hypocrisie putassière.
La compétition du Paris International Fantastic Film Festival de 2022 n’arrive pas tout à fait à la parité, mais déroule un panel de réalisatrices à la maîtrise esthétique et scénaristique ébouriffantes, d’une Lucile Hadzihalilovic au sommet de son art avec Earwig à la météore Mercedes Bryce Morgan et son superbe Fixation, sans oublier le glauquissime Huesera de Michelle Garza Cervera et le fendard Glorious de Rebekah McKendry.
Le carton du Smile de Parker Finn, avec son inattendu million d’entrées françaises, tend à démontrer qu’il existe un public prêt et dispo pour de l’horreur premier degré qui respecte son public (même si, comme le rappelle Marie Herny, il doit sans doute une partie non négligeable de son succès à une campagne virale très adroitement menée). Les reboots, remakes, requels, legacyquels et autres saletés marketing vilipendées dans le précédent numéro de MadMovies connaissent le même essoufflement que les refontes de classiques produites par Platinum Dunes à la fin des années 2000.
Encore plus étonnant, cette année 2022 propose coup sur coup trois œuvres capables de renvoyer les atrocités de la trilogie The Human Centipede et A Serbian Film à leur bac à sable rempli de déjections canines. The Sadness de Rob Jabbaz, Project Wolf Hunting de Kim Hong-sun (présenté au PIFFF) et Terrifier 2 de Damien Leone s’épanchent dans des représentations d’une violence graphique inédite dans les salles obscures, d’une méchanceté à s’en décrocher la mâchoire. C’est d’ailleurs avec ce dernier film que Shadowz se lance, avec ESC Films, dans l’aventure de l’exploitation cinématographique.
Ses 11 millions de recettes sur le territoire américain sont à mettre en balance avec son budget de 250.000 dollars en partie crowdfundé, et l’investissement de son auteur/réalisateur, également à la besogne sur les sidérants effets spéciaux.
Pour Aurélien Zimmermann, « c’est l’anti-elevated horror, un train fantôme, du pur cinéma d’exploitation. J’ai adoré Hérédité, la veine auteurisante A24 est intéressante, mais je n’ai pas envie de voir que ça. J’aime le bis des années 1980, la Category III, je pense qu’il y a un côté cathartique qui peut être tout aussi intéressant. Terrifier 2 a une vraie proposition artistique, il s’éloigne du slasher balisé. C’est un gros investissement pour nous : on sort le premier opus sur la plateforme Shadowz, et on fait une VF, ce qui est indispensable pour viser la rentabilité et toucher un public plus large. Après, je suis intimement persuadé qu’une œuvre violente ne sera jamais responsable de comportements violents, la culture est juste le bouc émissaire parfait et facile pour blâmer les dérives de la société, mais en vérité, elle agit en tant que défouloir sain. »
Sur cette arrivée d’un gore de combat, plus abject et bourrin que jamais, Marie Herny en reste à sa lecture du cinéma d’horreur comme meilleur moyen de prendre le pouls du moment. « Tu as l’impression que ça se passe bien, l’Humanité ? Je ne sais pas si je vieillirai assez pour voir le monde prendre feu, mais c’est bien amorcé, actuellement. Pour ce qui touche au gore, c’est la façon la plus décomplexée d’aborder les changements en cours. Le grotesque peut te permettre des effets, des histoires, énormément de choses. C’est donc à l’image de la société : foutu pour foutu, je vais tout cramer. Donc ça ne me surprend pas du tout. »
Julien Fonfrède observe lui aussi cette mutation du cinéma gore vers un versant plus malsain et viscéral, replié sur une acception plus individualiste, mais il n’exclut pas le retour d’un gore ludique, plus synchrone avec ce qui pouvait se faire dans les années 1980. Il place ainsi beaucoup d’espoir dans le passage au long-métrage du Japonais Ken’ichi Ugana, qu’il décrit comme un mélange entre Sam Raimi et Ricky Gervais.
Plus étonnant de notre point de vue volontiers dépréciatif sur la production nationale, il apprécie la nouvelle horreur made in France. « J’ai pris beaucoup de plaisir devant Coupez ! de Michel Hazanavicius. Et des films comme Grave, Titane ou La Nuée sont très justes en matière de réflexion, de spleen, de regard sur la société. Qu’on aime ou pas, on y voit des choses plus complexes, qui recommencent à parler du corps, qui viennent nous rappeler que ce dernier est au cœur de la peur et de la terreur. J’ai vu X de Ti West, le sujet est super, ça commence bien, puis après… OK, le corps des vieilles personnes fait peur, c’est malsain, mais tout ça se développe pour dire quoi ? J’ai trouvé ça un peu con, au fond. Je préfère voir Julia Ducournau dans Titane me parler de la chair, du corps, du sexe. »

– L’horreur indé US contre-attaque avec X de Ti West.SALO HOLOCAUST
Ultime surprise d’une année riche en rebondissements : le retour du public dans les salles, qui vient contredire les prédictions des Cassandre en tous genres – sans oublier le défilé de stars françaises blâmant la conjoncture en termes effroyablement maladroits, histoire de bien entériner la fracture de classe entre les sommités créatives et la plèbe ingrate.
Se posent toujours, néanmoins, les questions du vieillissement du public et de la désaffection des jeunes pour la salle à cause de leurs Internets et autres TikTok, de leur capacité de concentration en chute libre, ou encore de leur accoutumance à la disponibilité immédiate et gratuite des produits de consommation culturelle.
L’horreur semble être l’un des produits d’appel de cette génération forcément perdue, à égalité avec les films Marvel et les versions long-métrage de leurs animés de prédilection (One Piece Film – Red a frôlé le million d’entrées, Jujutsu Kaisen 0 colle aux basques du dernier Scream). Dans ces trois cas de figure, des vidéos captées pendant des séances, complaisamment relayées par les médias généralistes, témoignent régulièrement d’ambiances beaucoup trop survoltées pouvant virer à la foire d’empoigne faute de réponse appropriée.
Cette appréhension de la séance cinématographique virant à l’attraction de fête foraine ne date pas d’hier – les vétérans du Festival du Rex sont là pour honorer le devoir de mémoire, si besoin. Mais d’une part, l’usage extensif du téléphone portable amène effectivement son lot de perturbations inédites (c’est un daron qui a récemment engueulé une spectatrice de Smile parce qu’elle streamait la séance sur Twitch qui vous parle).
D’autre part, la bulle grossissante de l’information en continu se charge avec une redoutable efficacité du travail de stigmatisation de ceux que les éditorialistes nomment, avec cette pudeur qui les caractérise, « un certain public ». Aurélien Zimmermann sait pertinemment que de telles polémiques lui pendent au nez, Terrifier 2 arrivant précédé de sa petite réputation américaine, avec des ados qui se lancent le défi de savoir qui tiendra le plus longtemps devant son étalage d’atrocités

– Terrifier 2 et sa violence graphique inédite.L’équilibre reste à trouver, quelque part entre le surplus de sécurité des plus grosses avant-premières de films indiens, les messages de prévention désormais diffusés avant les sorties d’animés, et l’ambiance bon enfant mais électrique des plus grands festivals de cinéma de genre.
De sa sérénité montréalaise, Julien Fonfrède se montre optimiste sur le renouvellement du public. « Ce que je vois à travers un événement comme le nôtre, c’est qu’il y a toute une nouvelle génération de spectateurs, vraiment très jeunes, je dirais 16-17 ans, qui vient en masse. On ne sait pas d’où ils sortent parce qu’on ne les attendait pas ! Et ils sont là pour voir des films dérangeants. En tant que programmateurs, on est de plus en plus conditionnés par ce qu’on nous dit : “Ouh la, tu tends le bâton pour te faire battre, tu vas perdre un sponsor, tu passes un film problématique !” – Irréversible, pour ne pas le citer… Tu t’apprêtes à faire un discours de prévention et tu te rends compte assez rapidement que ces spectateurs savent très bien ce qui les attend. Salo de Pasolini a fait salle comble, devant un public majoritairement ado. Je pourrais passer Cannibal Holocaust et avoir le même résultat. Il y a un désir de subversion, de voir des choses qui dérangent, contrairement à ce qu’on tente de nous faire croire. »
Contre vents, marées contraires, ingérences contre-productives et dénigrements tous azimuts, l’horreur survit. Elle répète des cycles de son histoire récente, s’adapte, se compromet ou se radicalise. Quoi qu’il en soit, elle parvient toujours à nous surprendre.
– Par François Cau.
– Merci à Julien Fonfrède, Sabine Garcia, Marie Herny, Marie Rumignani et Aurélien Zimmermann . -
j’en regarde depuis que je suis petit des films d’horreur, je matais ca avec le grand père qui adorait ca aussi
et c’est que du bonus si le genre se renouvelle
-
@Ashura a dit dans [Dossier] Gore save the screen :
’en regarde depuis que je suis petit des films d’horreur,
Moi aussi j’ai toujours aimé ça et encore aujourd’hui et je pense que ça restera toute ma vie.
Les films de genre de manière générale et les films asiatiques sont ce que je regarde le plus.
-
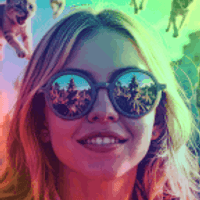 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


