[Interview] Daniel Kwan & Daniel Scheinert - Everything Everywhere All At once
-

À ceux qui se demandaient comment les Daniels allaient surenchérir dans l’absurdité après Swiss Army Man , les cinéastes opposent l’orgie mutante d’ Everything Everywhere All at Once et noient tous les doutes dans l’océan de leur imagination a priori sans limites. Ils reviennent pour nous sur leur processus de création.
- Le script d’ Everything Everywhere All at Once offre une base dramatique solide sur laquelle vous ajoutez une profusion d’idées toutes plus folles les unes que les autres, mais aussi toujours organiquement liées à votre propos. Comment avez-vous réussi à structurer tout ça ?*
Daniel Scheinert - Il y a eu beaucoup de tâtonnements. (rires) Nous avons écrit tout un tas de versions avant de réaliser qu’à nos yeux, cette base dramatique n’était pas assez forte. Après avoir passé autant de temps à développer toutes ces idées de science-fiction, c’est devenu un point crucial. Notre but n’était pas de livrer un film absolument personnel ou émouvant, mais cette épaisseur dramaturgique est devenue une nécessité pour donner une cohésion à l’ensemble.
Daniel Kwan- Nous avons dessiné beaucoup de diagrammes. Je suis quelqu’un de très visuel, donc nous nous sommes mis à imaginer ces espèces de plans - du genre plan de métro - pour chaque univers.
D.S - On a recouvert un mur de post-it !
D.K - … et tous ces univers étaient disposés en cercles concentriques. On commence avec cette famille, puis on agrandit le canevas selon une forme de toile d’araignée… C’était une approche très chaotique, mais aussi assez scientifique. (rires)
D.S - Ce qui nous a été le plus utile, c’est le fait de nous entrainer à pitcher le film à l’oral. Une fois, des amis nous ont servi de cobayes, et ça nous a pris 2h30 - plus longtemps que le film ! — juste pour faire ce pitch. Mais ça nous a permis de vérifier que l’aspect émotionnel fonctionnait.
- Réussir à connecter en permanence tous ces éléments a dû être un véritable cauchemar…
D.S - Parfois, oui, mais nous avions déjà pas mal expérimenté sur le montage sur des formats plus courts, et nous savions que ça pouvait marcher. Ce n’est pas la première fois que nous imaginons des gimmicks qui permettent de donner vie à des concepts qui peuvent paraître flous sur le papier.
D.K - Durant l’écriture, on a souvent le sentiment de se noyer dans le flot de nos idées, d’en perdre le contrôle, mais c’est aussi là qu’on se dit qu’on tient quelque chose d’intéressant ! (rires)

- D’une certaine manière, vous procédez dans le sens inverse de Swiss Army Man, qui était une idée tarée illustrée de façon sérieuse. Là, vous proposez une histoire sérieuse parasitée par un déluge d’idées tarées.
D.S - Oui, nous voulions aller dans une autre direction, avec plus de deux personnages. et des personnages vivants. (rires) Mais il y a aussi pas mal de similitudes, car on aime juxtaposer des émotions et des idées différentes. Les deux films reposent sur des traitements inattendus.
D.K - D’une certaine façon, Swiss Army Man a été plus compliqué à faire parce qu’il ne comportait qu’une seule histoire, assez simple qui plus est, et la marge d’erreur était donc bien plus restreinte. Dans Everything Everywhere All at Once, il se passe tellement de choses que même si vous n’aimez pas un univers en particulier, une blague ou un autre aspect, le mouvement est permanent. Je pense que c’est pour ça que le public reste ouvert et pardonne beaucoup au film.
- Jusqu’à quel point avez-vous développé chaque univers ?
D.S - Nous avons passé beaucoup de temps à essayer de les différencier. Nous savions que ce serait marrant à faire, que nous n’avions pas à nous cantonner à un seul style de mise en scène ou à une seule palette de couleurs. Nous avons donné la permission à chaque département de se lâcher, de jouer avec les possibilités de chaque univers. Nous avons également essayé de nous appuyer sur des esthétiques qui nous ont marqués, et le film est devenu une déclaration d’amour aux cinéastes et aux artistes que nous adorons. On y trouve des bouts de Wong Kar-Wai, des clips de Michel Gondry…
D.K - Ces références n’étaient pas le point de départ du projet, elles sont venues bien après, durant la production. Chaque univers devait avoir son importance narrative. Celui où le personnage de Michelle Yeoh est une star de cinéma, où elle rencontre son mari dans un autre contexte, vient du fait qu’il était difficile de s’impliquer dans leur relation de base, celle de l’univers de départ. Ils ont vécu ensemble si longtemps, ils se sont éloignés l’un de l’autre. Je me disais que j’aimerais pouvoir voyager dans le temps et assister à leur première rencontre, les voir tomber amoureux. Et je ne voulais pas recourir aux flashes-back, même s’il yen a quelques-uns dans le film. C’est là qu’est venue l’idée de les faire se croiser après qu’ils se sont perdus de vue : ça « débloque » l’aspect sentimental de leur relation. Même si on s’amuse avec tous ces genres, leur utilisation vient avant tout des besoins des personnages.
- Votre film est une incroyable déclaration d’amour à vos comédiens principaux, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan. À quel stade de la production ont-ils été impliqués ?
D.S -On a écrit le script pour Michelle Yeoh, et on avait bien évidemment peur qu’elle refuse, ou de découvrir quelqu’un de désagréable en la rencontrant… Et ç’a été tout le contraire. Elle est arrivée à bord en 2018, et le film n’aurait jamais vu le jour si elle n’avait pas réagi avec autant d’enthousiasme. Pour le rôle de Waymond, nous avons fait passer des auditions, et Ke s’est présenté. J’ai d’abord cru qu’il s’était déguisé comme le personnage pour nous faire marrer, mais il est exactement pareil dans la vraie vie : simple, souriant, tellement adorable que tu as parfois envie de lui demander d’arrêter d’être trop gentil ! (rires) Il était parfait pour le rôle. 11 est arrivé cinq mois avant le début du tournage, et quand il a rencontré Michelle, les choses ont pris un tour encore plus exaltant car ils se sont parfaitement entendus, comme avec le reste de la famille d’ailleurs. C’était un miracle de pouvoir le faire jouer à nouveau, il est tellement talentueux. C’est terrible qu’il ait arrêté la comédie pendant vingt ans.
- Quelle image aviez-vous de Michelle Yeoh en tant que cinéphiles ?
D.K - Mon père vient de Hong Kong, il a émigré à New York quand il avait 5 ou 6 ans. Il y avait un cinéma à Chinatown qui ne jouait que des films de Hong Kong et il a grandi avec les productions de la Shaw Brothers. Quand a débarqué la génération des Jackie Chan, Jet Li ou Michelle Yeoh, avec tous ces films géniaux, il ne ramenait que ça à la maison, d’autant que ma mère ne voulait voir que des longs-métrages en chinois. Je crois que la première fois que j’ai vu Michelle Yeoh, c’était dans Police Story III. Quand j’ai dit à mon père qu’on tournait avec elle, il est devenu fou ! Je crois qu’il en sait plus sur sa vie qu’elle-même - d’ailleurs, ils se sont rencontrés, et elle est plutôt d’accord, (rires) Je pense n’avoir jamais vu mon père aussi heureux qu’à la fin de la projection du film. Maintenant, Michelle est une bonne amie, une tante exemplaire pour mes enfants. C’est une personne merveilleuse, on a vraiment de la chance.
D.S - Je regardais beaucoup de films quand j’étais gamin, et c’est la découverte du cinéma de Hong Kong qui m’a donné envie de devenir réalisateur. Le premier truc que j’ai tourné, c’était un film de kung-fu dans le jardin de mes potes. (rires) Il y a un vraiment un enthousiasme contagieux dans ce cinéma.
- Parmi vos influences, vous citez Satoshi Kon, et il est clair qu’on retrouve chez vous cette même lisibilité, cette fluidité dans le déferlement d’informations balancées aux spectateurs.
D.K - Le travail de Satoshi Kon est absolument dingue, et ce qui ne trompe pas, c’est à quel point il a « inspiré » tant de réalisateurs. De notre côté, nous cherchions à retrouver la même énergie, à nous inspirer de son approche du surréalisme pour créer des images inédites. Nos cerveaux carburent à plein régime parce que nous faisons partie de la première génération à avoir grandi avec Internet. On traite les informations à une telle vitesse qu’il m’arrive de m’ennuyer devant des films, j’ai besoin d’être plus stimulé, pour le meilleur et pour le pire. Everything Everywhere All at Once reflète cette époque. D’une certaine façon, nous avons voulu voir ce qu’un public contemporain était capable d’encaisser, ce qu’il pouvait retenir d’une telle narration, c’est quasiment un stress-test ! C’est hallucinant de voir à quel point le public est capable de se prendre ce déluge d’images en pleine poire et d’apprécier l’expérience. Même si tout n’est pas assimilé, la réaction émotionnelle est la bonne. Aujourd’hui, trop de spectateurs intellectualisent ce qu’ils regardent, au lieu de simplement ressentir les émotions. On a voulu inverser ce rapport.

- L’équipe du film compte beaucoup d’autodidactes, notamment dans les domaines des effets spéciaux et des cascades. Comment cela a-t-il influencé le projet d’un point de vue artistique ?
D.S - Nous avons débuté en bricolant des courts-métrages que nous balancions sur YouTube et Vimeo. À l’époque, on a croisé beaucoup d’aspirants réalisateurs qui, comme nous, profitaient de ces nouvelles technologies, des tutoriaux qu’on trouvait sur le Net, etc. Les producteurs nous ont dit qu’il allait falloir énormément d’argent pour monter Everything Everywhere All at Once, et quand nous avons découvert le montant du budget dont nous allions disposer, nous nous sommes retrouvés face à deux choix : soit couper beaucoup de pages, soit bosser en mode système D, revenir aux méthodes que nous utilisions à l’époque de nos premiers courts. Nous avons embarqué tous nos amis sur le projet, bidouillé les effets spéciaux sur nos ordinateurs personnels… Les cascadeurs étaient à la fois professionnels et amateurs ; les chorégraphes, par exemple, viennent de YouTube, ils mettaient en scène des combats dans leur jardin ! Je suis persuadé qu’au-delà des économies budgétaires, ça donne au film un côté particulier, presque « fait à la maison ».
D.K - Les contraintes sont un atout, en particulier dans un film aussi dingue que celui-ci. On ne pouvait pas avoir des effets spéciaux élaborés, réalistes. Nous nous sommes plutôt attachés à concevoir des choses marrantes, intéressantes, voire esthétiques, en nous inspirant du motion design, des films des années 1980 comme S.0.S. fantômes. Nous n’avons jamais essayé d’entrer en compétition avec les productions Marvel et leurs ressources illimitées. Pour les combats, on ne disposait pas de centaines de belligérants, avec des mouvements de caméra déments… Mais on pouvait se permettre d’avoir au moins deux excellents artistes martiaux. C’est ce qui nous a fait tomber amoureux des films de Hong Kong : leur simplicité, leur confiance absolue dans les interprètes. On voulait revenir à ça.
- Cet aspect fait de bric et de broc est bien plus organique qu’un énième blockbuster doté de CGI parfaites…
D.K - Il y a aujourd’hui une obsession similaire pour le photoréalisme dans le jeu vidéo. Pour beaucoup, cette qualité serait le seul marqueur technologique du medium. C’est oublier la beauté qu’il peut y avoir dans un style très spécifique, dans une texture qui n’essaie pas d’imiter quoi que ce soit, mais qui au contraire a son identité propre. J’ai l’impression qu’on trouve les mêmes problématiques dans les films aujourd’hui.
- Si l’on en juge par certaines réactions très touchantes qu’on peut lire en ligne, Everything Everywhere All at Once est sorti à un moment décisif pour la communauté asiatique américaine, à une période où celle-ci est souvent prise pour cible.
D.K - On ne pensait vraiment pas que ce serait le cas, non seulement pour la communauté asiatique américaine, mais aussi pour la diaspora asiatique en genéral. À travers le monde, des spectateurs asiatiques s’identifient au film d’une façon à laquelle on ne s’attendait pas. C’est bien sûr l’un de ses thèmes, mais nous ne voulions pas pour autant que cela prenne le dessus sur le reste. Et c’est Ça, je crois, qui motive cet engouement : Everything Everywhere All at Once n’est pas vendu comme un film sur la communauté asiatique, c’est un élément de l’intrigue comme un autre. Je pense que le récit conserve un côté universel et montre que des personnages asiatiques peuvent inspirer des sentiments qui entrent en résonnance avec tout le monde. Nous sommes ravis que le film sorte enfin en France, même si on se dit que ce qu’on est sans doute trop immatures pour vous !
Propos recueillis par François CAU
Merci à Tristan Du Laz, Gwendolyn Elliott et Jean-François Gaye -
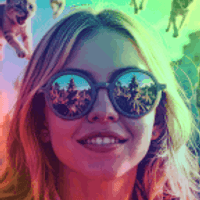 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
-
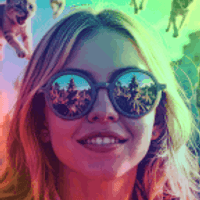 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
-
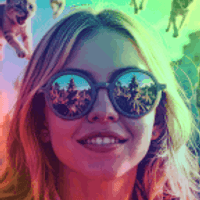 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


