[Dossier] L'enfer des reboots, l'originalité écorchée
-

Si la folie consiste à recommencer toujours la même chose en s’attendant à un résultat différent, reproduire ad nauseam les mêmes schémas tout en espérant un résultat similaire n’est-il pas tout aussi dément ? À l’approche des bilans de fin d’année, faut-il se réjouir du rebond du box-office quand celui-ci n’est rempli que de licences artistiquement essorées ? A-t-on vraiment besoin d’un onzième Hellraiser ? Tant de questions rhétoriques, autant de réponses de mauvaise foi et de raccourcis à main armée.
Dans la saison 3 de l’excellente série Barry produite par HBO, le personnage de Sally Reed porte à bout de bras un projet de série inspirée de son propre vécu de femme battue. Les critiques sont dithyrambiques, le public adore… Mais le show disparaît de la page d’accueil de la plateforme qui le produit douze heures après sa mise en ligne. Et Sally d’apprendre son annulation dans la foulée. La raison invoquée ? L’algorithme en a décidé ainsi. « Ça va faire trente ans que je fais ce métier » lui dit ainsi la big boss, « et si j’ai appris quoi que ce soit, c’est que personne ne comprend rien à rien, sauf l’algorithme. »
Cet épisode rappelle aux infidèles à quel point l’écriture de Barry est une [censored] merveille dans sa manière de nager à contre-courant. Il n’y a pas que la plateforme à la lettre « N » rouge dans son collimateur : sa diffusion coïncide avec la clôture d’un exercice fiscal compliqué, au gré duquel les plus grosses productions du studio Warner sont sorties conjointement sur la plateforme HBO Max.
Ajoutez à ce bilan pour le moins contrasté les incessantes et absurdes mutations de l’univers cinématographique DC Comics, l’arrivée pétaradante de David Zaslav à la tête du studio et ses changements de braquet au frein à main sur une route verglacée, et vous obtenez le stade terminal de la transposition des logiques capitalistes à l’industrie du 7e Art.
Les « tentpoles », ces énormes machines budgétisées à 150 millions de dollars minimum, ont avalé les blockbusters plus modestes et autres bisseries intermédiaires. Le public doit impérativement connaître l’univers pour lequel il va débourser ses vingt dollars en multiplexe. Ne comptent que les « IP », les Intellectual Properties déjà identifiées. Il peut s’avérer plus rentable de ne pas sortir un film déjà tourné (coucou Batgirl).
Tout ne doit être que projections de satisfaction, rationalisation des coûts sur des secteurs jugés accessoires (comme les effets spéciaux numériques), lissage de complaisance avec les tendances observées sur les réseaux sociaux, rentabilité à court terme – la seule vision d’avenir autorisée s’opère sous la forme de ces satanées frises chronologiques d’univers super-héroïques étendus.
Dans ses indispensables documentaires Pandora’s Box (1992) et All Watched Over by Machines of Loving Grace (2011), le visionnaire Adam Curtis liait une partie de l’Histoire du XXe siècle à son investissement aveugle et extatique dans l’informatique, où nous avions chevillée au corps cette croyance mystique que les ordinateurs allaient nous sortir de la panade et nous élever collectivement. Mais comme tout système politique, social, philosophique ou religieux, il fallait bien que ce mode d’organisation soit détourné à des fins de profit personnel.
À Hollywood, les crises économico-pandémiques et les pertes colossales dues au désamour du support physique ont servi d’accélérateurs. Les chiffres, analyses et études ne sont désormais plus que des paravents derrière lesquels se planquent des exécutifs sans panache, tous morts de trouille à l’idée de pousser une idée originale. Tout ne doit être que suite, remake, reboot.

Matrix Resurrections : un braquage méta.Jurassic Jam
Il est injuste de tout mettre sur les épaules de la Warner quand son cirque organisationnel ne fait que rendre sa déroute créative plus visible – la boîte à Mickey charrie encore plus de casseroles, ne serait-ce que sur l’année écoulée. Il faut en outre reconnaître à Warner d’avoir produit, en amont de sa débâcle, deux aberrations méta hallucinantes qui resteront sans nul doute, a posteriori, comme deux des commentaires les plus éloquents sur leur époque.
Matrix Resurrections de Lana Wachowski est un acte de flibusterie insensé, portant en lui son inutilité existentielle. La réalisatrice y avoue sans ambages qu’il ne s’agit là que d’une entreprise de maintien illusoire de sa création dans son giron contre les bureaucrates du studio, quasiment nommés comme tels.
Le cas Space Jam : nouvelle ère de Malcolm D. Lee surpasse presque son homologue dans le domaine de la double lecture offensive, avec un surplus d’hypocrisie laissant un arrière-goût d’amer foutage de gueule en fond de gorge. LeBron James y joue encore moins bien que Michael Jordan dans le film original de 1996, il y a donc tout l’espace disponible pour se focaliser sur l’ennemi : une intelligence artificielle incarnée par l’affable et charismatique Don Cheadle.
C’est peu dire que celui-ci prend l’ascendant sur le héros supposé du film dans toutes leurs scènes en commun, et ses motivations en sembleraient presque légitimes. Notre antagoniste sympa, nommé Al-G Rhythm (sic), ne vise rien moins qu’à absorber toutes les créations Warner Bros. pour les proposer à portée de clic.
Et de fait, la mise en scène ne semble pas fermement décidée à prendre parti dans le débat, tant elle jubile à aligner un demi-siècle de créations emblématiques pour figurer les supporters du match, des Warboys de Mad Max: Fury Road aux Drougs d’Orange mécanique, sans oublier la sœur Jeanne des Diables de Ken Russell – un comble, quand on connaît l’historique de censure et de rétention du studio vis-à-vis du film.

LeBron James dans Space Jam : nouvelle ère fait pire que Michael Jordan dans la version de 1996.En l’état, impossible de savoir si cet affront, répété dans un nombre invraisemblable de plans, relève de la contrebande de pirates cachés dans l’équipe de production, d’un vaste doigt d’honneur, ou de l’œuvre d’un jeune foutriquet qui aurait trouvé ça cool. Il en va de même de tout le film, d’une laideur invraisemblable, d’un déséquilibre global tel qu’il est impossible de savoir si la fin est un happy end ou non – est-ce une bonne chose qu’Al-G Rhythm ait perdu ? Lebron James est-il vraiment devenu un meilleur père ? Nul ne le saura jamais et il est tout à fait plausible que tout le monde s’en tamponne le coquillard.
Le même flou, tout juste artistique grâce à l’apport modeste de J.A. Bayona à la franchise, anime la trilogie Jurassic World. Le premier film de Colin Trevorrow est un pur « requel », néologisme marketeux pour désigner une suite lointaine reprenant les éléments dramaturgiques du premier volet, à la limite du remake pur et simple. Il s’y dessine une amorce de discours, un embryon de mise en abyme sur le besoin de satisfaction d’un public blasé, qui se noie dans des séquences d’action plus mal fichues et bien moins crédibles que chez tonton Steven. La sidération de 1993 n’est plus qu’un vague souvenir auquel s’accrocher désespérément.
Le deuxième épisode signé Bayona développe une piste passionnante sur le clonage humain, une autre pleine de potentiel sur le marché noir des dinosaures, un soin plus affirmé à la mise en images… et Jurassic World : le monde d’après n’en fera absolument rien.
Ce troisième film ne sait visiblement pas quoi foutre de ses personnages ou de ses dinosaures, évide une intrigue bancale centrée sur des sauterelles mutantes, balance un épilogue inepte en forme de publicité sirupeuse pour la COP 27. Même dans son extended cut, Le Monde d’après semble raboté de partout comme le fut en 2019 Star Wars : l’ascension de Skywalker, avec pour figure de proue du massacre sa fameuse couleuvre scénaristique du retour jamais expliqué de Palpatine.

Jurassic World : le monde d’après ou le renoncement artistique.Tu seras un boss, mon fils
L’arrivée des acteurs originaux (Laura Dern et Sam Neill en renfort de Jeff Goldblum, déjà présent dans le 2) n’apporte absolument rien à cette nouvelle franchise, leur écriture va jusqu’à trahir leur caractérisation originelle. Il en va de même pour l’irruption finale des Ghostbusters historiques dans S.O.S. fantômes : l’héritage de Jason Reitman. Sans même parler de l’utilisation d’images d’archives pour ressusciter le pauvre Harold Ramis, leur scène tire en longueur, à la ligne, à blanc. On a moins l’impression de retrouver les personnages que leurs seuls interprètes dans le rôle de cautions moralo-nostalgiques.
Cette tentative de passage de relai aux jeunes générations a elle aussi son appellation fumeuse : le « legacyquel », porté notamment par la franchise Creed, grande trahison idéologique de son matériau de base s’il en est. Autant Rocky Balboa avait l’authentique dalle du boxeur issu de la rue, autant Adonis n’apparaît en définitive que comme un gamin capricieux à l’ego mal géré, quitte à faire passer ses adversaires pour les vrais héros de ses films – soit le problème de positionnement que n’arrive pas à dépasser la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel.
Un réalisateur américain semble mieux avoir compris que ses petits camarades les enjeux de telles productions, et leur sert la soupe avec la mise en scène adaptée. Avec Tron : l’héritage, Joseph Kosinski crée un univers visuel à la fois cohérent avec son modèle et saisissant dans sa mise à jour des jeux de perspective de 1982. Ce faisant, il s’émancipe d’un script laborieux, mal rythmé et conclu par le reniement des principes du héros au profit des joies du patronat.
Alice au pays des merveilles de Tim Burton, sorti la même année, s’achevait sur une note similaire. L’impact de cette tendance « entrepreneuriale » reste encore difficile à jauger, si ce n’est qu’elle a décomplexé la refonte des grands classiques à l’aune de la promotion d’un capitalisme conquérant.
Avec Top Gun: Maverick, Kosinski fait encore plus fort : son euphorie à rejouer des motifs du film de Tony Scott, sa mise en abyme pasolinienne de l’être-Tom-Cruise-au-monde parvient à faire oublier que le script n’est qu’une longue apologie de la violation du droit international portée par des bonshommes à l’ancienne, pas déconstruits pour deux sous en dépit de petites touches de discrimination positive dans le casting. La désillusion face au piteux Spiderhead du même Kosinski, sur Netflix, n’en fut que plus douloureuse – vendez-nous du rêve américain, mais faites-le bien, au moins.
En 2017, le relooking à la sauce Stranger Things du Ça de Stephen [censored] par Andrés « mais appelez-moi Andy » Muschietti défie toutes les attentes et cartonne mondialement. L’espoir du retour d’un cinéma de genre du milieu par le truchement horrifique naît chez les éternels optimistes… et la sortie de la deuxième partie en 2019 se charge de remettre les pendules à l’heure.
Ça : chapitre 2 est un objet informe de trois heures atrocement rythmées, répétitives à s’en pendre à ses propres tripes, truffées de problèmes de production donnant parfois l’impression de voir une copie de travail. Cette séquelle suinte le compromis et les renoncements, une sale odeur d’ingérence « pragmatique » se dégage de son montage parfois incompréhensible.
La flopée de remakes de classiques horrifiques produits dans les années 2000 jusqu’au début de la décennie suivante – parfois avec talent dans le cas du Evil Dead de Fede Alvarez – n’était qu’un coup de semonce. Porteuse en des temps immémoriaux de messages subversifs, l’horreur charrie désormais les lourds stigmates de la disette créative contemporaine et de son flou rhétorique, en dépit de ses enjeux économiques a priori moindres.
La grande entreprise de destruction algorithmique se répand, elle amène la discorde dans les pages de la rédaction de Mad et nous promet une discussion bilan de fin d’année animée. Après la relative magnanimité étalée au fil de l’eau dans les Cinéphages, place au défouraillage rétrospectif.

Le Scream de 2022 est une suite de climax troussés dans cette satanée esthétique gris-bleu des années 2010.le mal meurt ce soir !
Tous les films Scream réalisés par Wes Craven avaient leurs morceaux de bravoure en forme de miroir tendu à la fois aux protagonistes et aux spectateurs, dans le cadre d’un lieu lié au cinéma. Le cinquième film réalisé par Matt Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett n’aligne que des climax troussés dans cette satanée esthétique gris-bleu des années 2010, sans relief, sans émotion.
La mort d’un personnage canonique suscite plus de colère qu’autre chose, faute de construction appropriée. Il en va de même pour le discours final sur les fans toxiques et l’inévitable mise en abyme du retour au premier film pour contenter son monde – une fois le retournement de situation et ses aboutissants éventés, un re-visionnage ne fait que confirmer à quel point cet aspect n’est qu’esquissé et jamais réellement traité.
Le film tombe droit dans l’écueil évité par la saga jusque-là : une œuvre consciente d’elle-même ne gagne pas de passe-droit, il lui faut développer ses partis pris au-delà du seul grand-guignol pour espérer exister.
Cet aspect plombe le Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia de manière inattendue, dans son impardonnable scène de tuerie dans un bus retransmise en direct sur Snapchat. Le prisme méta n’a absolument rien à faire là, l’humour ne marche ni de façon volontaire ni involontaire, Leatherface n’est pas un influenceur barbaque, point à la ligne.
À partir de cet instant précis, le film perd tout de sa petite pertinence développée cahin-caha autour des thèmes de la gentrification, de la guerre des classes et des générations. La mise en scène parvenait à faire avaler tant bien que mal le caractère implausible du long ermitage de notre boucher de cœur, le sadisme troupier de la fin vient tout salir, sans même parler de cette guérison du traumatisme d’une rescapée de tuerie de masse par les armes à feu.

L’impardonnable scène méta du bus de Massacre à la tronçonneuse (2022).La trilogie Halloween tout juste achevée bouillonne de ce même flou idéologique à compter de son deuxième épisode. D’une méchanceté inédite dans la saga via ses mises à mort de personnages complaisamment présentés comme innocents et sans défense, Halloween Kills tente en sus de s’emparer du phénomène de meute et, à défaut de traitement, bascule dans le self-service interprétatif.
Le film a beau avoir été tourné un an avant les événements, il a été analysé à la fois comme une parabole des émeutes liées au mouvement Black Lives Matter (par Jamie Lee Curtis elle-même) et comme une satire de l’invasion du Capitole. L’absence de didactisme pourrait être saluée si la conclusion de cet arc narratif ne tendait à se satisfaire de ses seules prémisses provocatrices.
Halloween Ends souffre de la même absence de ligne directrice, de la même frilosité à traiter des pistes discursives pourtant lancées par ses soins. Pire, il le fait en contradiction presque totale avec les deux films précédents, en particulier du point de vue du personnage de Laurie Strode, dont l’évolution d’un film à l’autre n’a strictement aucun sens.
Il y avait clairement du potentiel dans cette appréhension du mal comme une entité intangible, dissociée de Michael Myers pour devenir un virus rampant, mais le film n’a pas suffisamment confiance en lui pour poursuivre dans cette voie. Le dernier acte semble se rappeler subitement son appartenance à une franchise et revient aux fondamentaux halloweenesques, comme s’il se rebootait lui-même en cours de route.
Il est impossible de reprocher à la trilogie de David Gordon Green de ne pas tenter des choses, le problème étant qu’elle ne sait pas quoi faire de toutes ses expérimentations, qu’elle en revient invariablement à des figures imposées.
Les mêmes soucis structurels frappent l’honnête Prey de Dan Trachtenberg, condensés par la première scène avec les trappeurs : pour qui ne parle pas la langue, l’angoisse démarre au quart de tour. Pour les francophones, l’ambiance est flinguée par le phrasé et les dialogues approximatifs d’interprètes pourtant convaincus. Le réalisateur apporte un soin maniaque à son atmosphère, à sa direction d’acteurs, mais désamorce dans le même temps des éléments fondamentaux, comme le fait que quiconque a vu ne serait-ce qu’un film Predator a fatalement plusieurs coups d’avance sur l’intrigue.

Michael Myers (The shape) dans Halloween Ends, à la recherche d’une ligne directrice.Pour l’honneur de Clive
Inutile en revanche de revenir sur le mauvais procès en wokisme subi par Prey : choisir une héroïne, comanche de surcroît, est totalement justifié d’un point de vue narratif. Pour qui chercherait à se défouler sur une œuvre drapée dans sa bonne conscience opportuniste, il y aurait bien le remake de Black Christmas de 2019 ; d’une bêtise crasse dans son exécution, il réussissait l’exploit assez impressionnant d’être au final bien moins progressiste que le film original de Bob Clark. Inutile de déterrer les morts, jusqu’à deux lignes en arrière, vous aviez oublié jusqu’à son existence…
Il y a infiniment plus matière à débat autour du Candyman de Nia DaCosta et son appartenance assumée par ses maîtres d’œuvre à la catégorie honnie de l’elevated horror. Honnie parce qu’elle établit des hiérarchies vaseuses et place ses apôtres revendiqués sur un piédestal contestable. La réalisatrice et son scénariste/producteur Jordan Peele n’ont pas manqué de mettre en avant le propos de leur film sur la gentrification, les résonances avec le passé, les légendes urbaines…
Autant d’éléments que le film de Bernard Rose abordait déjà en 1992, avec une approche qu’il est permis de trouver plus audacieuse que celle de la nouvelle version. Tout comme il est permis, à l’instar du critique américain Walter Chaw, de trouver d’extrême mauvais goût le fait d’avoir baptisé un personnage de galeriste détestable du nom de Clive Privler, en « hommage » à l’auteur de la nouvelle originale, Clive Barker.

Prey, prévisible pour tout amateur de la franchise Predator.Il faut rappeler à quel point les relations entre Barker et le 7e Art ont toujours été conflictuelles, depuis ses mésaventures sur la production de Cabal jusqu’à la façon dont les frères Weinstein lui ont témoigné un mépris honteux dans leur exploitation de la franchise Hellraiser – les lecteurs assidus de MadMovies se souviennent sans doute du récit halluciné d’Alexandre Bustillo et Julien Maury de leur visioconférence avec Barker, tandis que l’immonde Harvey Weinstein se permettait d’insulter l’auteur en off pour forcer la connivence avec les Frenchies.
À cet égard, c’est peu dire qu’un onzième film Hellraiser ne suscitait guère d’enthousiasme à l’éclairage de ce qu’était devenue la franchise. Les premières informations rassurent vaguement : le réalisateur, David Bruckner, ne fait que confirmer les espoirs placés en lui depuis sa participation au projet The Signal en 2007. Si le redouté David Goyer est crédité au scénario, il apparaît aux côtés de Ben Collins et Luke Piotrowski, à l’ouvrage sur le très bon La Proie d’une ombre de Bruckner. Le casting de Jamie Clayton dans le rôle du Prêtre des Enfers (qui, selon Clive Barker dans l’incroyable roman Les Évangiles écarlates, déteste qu’on l’appelle « Pinhead ») n’est pas la « concession woke » évoquée par des plaisantins mal renseignés, mais bel et bien un retour à la caractérisation androgyne de ce personnage dans la nouvelle originelle.
Vient l’heure tant redoutée de visionner le produit fini, après plus de vingt ans de gang bang infernal de cette saga au potentiel cauchemardesque à peine effleuré avec un couteau rouillé. Et soudain, à défaut de miracle, l’anomalie dans le panorama du reboot : un film respectueux de son matériau de départ, qui le comprend et entreprend de le prolonger sans s’embarrasser de répondre à un cahier des charges algorithmique.
 ***
***
Candyman version 2021, l’elevated horror à tout prix.***Mourir d’horreur enchaîné
Oui, Hellraiser cuvée 2022 accuse un fâcheux ventre mou passé son premier tiers, et il lui manque cette sexualité vénéneuse qui irriguait le premier film (quand elle ne virait pas au soft porn dans les troisième, cinquième et huitième épisodes).
Le film n’est pas là pour révolutionner la franchise mais bien pour lui redonner du lustre et réparer tout le mal qui lui a été fait. Même s’il semble en prendre le chemin, ce Hellraiser rompt avec la dynamique des slashers par d’habiles torsions, toutes au service du récit. Le script convoque les aspects fascinants de sa mythologie – comme le dieu Leviathan, aperçu dans le mémorable Hellraiser 2 : les écorchés de Tony Randel –, reprend l’idée d’un prolongement architectural du cube élaboré dans le mal-aimé quatrième opus, s’approprie la meilleure idée du très bancal septième avec un personnage féminin torturé mais intègre, qui voit clair dans le jeu des Cénobites.
Moins drôle que l’impayable Kari Wuhrer dans Hellraiser: Deader avec ses clopes au bec et son perfecto en cuir, Odessa A’zion campe une antihéroïne crédible, badass et fragile dans un équilibre toujours maîtrisé. Goran Visnjic semble né pour jouer les âmes damnées avec un mécanisme lui ravageant les entrailles, et Jamie Clayton fait taire toutes les critiques dès son impériale arrivée. Elle honore le maintien et le port démoniaque de Doug Bradley, visage clouté emblématique de la saga mis à mal par ses deux successeurs punkoïdes.
De la direction artistique à la photo, sans oublier des scènes gore inspirées, ce Hellraiser a été manifestement concocté par une équipe qui a potassé son sujet et surtout, qui l’aime avec violence et déférence.

Hellraiser selon David Bruckner lustre la franchise sans la révolutionner.Dans Les Évangiles écarlates, Clive Barker orchestrait la rencontre entre son détective privé de l’occulte, Harry d’Amour et le Cénobite en chef, alors que ce dernier fomente une révolution aux enfers. L’auteur, trop longtemps lésé, récupérait les clés de son univers pour en révéler toutes les monumentales possibilités et en rappeler les fondements : non, Le Prêtre des Enfers n’est pas n’importe quel boogeyman courant après des adolescents priapiques et des loubards de troisième zone.
La franchise Hellraiser a tant de choses merveilleuses à nous montrer, et David Bruckner rouvre cette brèche fermée par des décennies d’irrespect flagrant. Il ne s’agira peut-être que d’un événement isolé, comme le furent le premier Halloween de David Gordon Green ou le Evil Dead de 2013. Le cinéma américain aurait tout intérêt à s’en inspirer, il n’en fera rien, coincé dans ses replis comptables. Quand bien même, les propositions décentes, pas encore salopées par des intérêts aussi rationnels que contradictoires, sont devenues beaucoup trop rares pour être refusées.
Par François Cau
Mad Movies #365 -
Hâte de voir ce que donne le Hellraiser de Bruckner pour me faire un avis
-
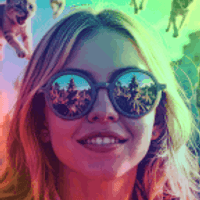 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


