[Dossier] Ennio Morricone
-

À l’heure où le documentaire Ennio célèbre la mémoire d’ Ennio Morricone en évoquant les plus grandes heures de sa carrière, Il nous a paru indispensable de nous pencher sur les zones d’ombre de sa filmographie, ses escapades dans les « Mauvais genres » qui nous tiennent tant à cœur.
De par la longévité du bonhomme, nous avons tous une histoire avec Ennio Morricone. Une histoire qui touche à l’intime, où sa musique devient un peu la compagne de notre vie, de certains de ses moments les plus marquants. Pour l’auteur de ces lignes, elle commence au tout début des années 1970, avec le 45 tours d’Il était une fois dans l’Ouest qu’écoute en boucle un oncle fan de western. Suivront une compilation interprétée par Geoff Love et son orchestre, parallèlement à la découverte des films de Sergio Leone à la télévision, puis de la série Marco Polo, de Peur sur la ville, de Queimada, de 1900…
Puis vint le déferlement émotionnel ressenti à la vision d’Il était une fois en Amérique en salle, puis l’exaltation procurée par l’incroyable ouverture des Incorruptibles et le plaisir éprouvé bien des années plus tard en plongeant tardivement dans les premières œuvres de Dario Argento. Avec le recul, on se dit qu’on a eu une chance folle d’avoir été initié aux délices de la musique de film par un tel mastro, et on plaint ceux qui l’ont été par Pirates des Caraïbes… Mais la musique de Morricone a ceci de particulier qu’elle embrasse plusieurs générations et a su créer un lien presque organique avec chacun de ses auditeurs : ce n’est pas un hasard si les fans du compositeur sont aussi passionnés, aussi complétistes, au point d’acheter dix fois de suite la même B.0. parce que chacune de ses rééditions propose une nouvelle variation sur le thème principal. Mais si l’artiste est connu dans le monde entier pour certains de ses chefs-d’œuvre absolus, l’exploration des zones plus obscures de sa discographie permet de mettre en lumière un corpus rarement évoqué, celui du Morricone du bis italien et autres trésors furieusement mad !
Au delà des Dollars
Sergio Corbucci, Giulio Petroni, Sergio Sollima, Duccio Tessari : lorsqu’il ne collabore pas aux westerns de Sergio Leone, Morricone ne s’associe qu’avec les ténors du genre. Et si aucun des scores signés pour les réalisateurs précités n’atteint la puissance de la trilogie des dollars, d’Il était une fois dans l’Ouest ou d’Il était une fois la révolution, il n’en demeure pas moins que Morricone reste, y compris dans ses œuvres mineures, le maître du western italien. Comme chez Leone, il déploie des instrumentations singulières : carillons, klaxons, célesta, harmonium, guimbarde sicilienne, crépitements de guitares, sifflements le plus souvent assurés par Alessandro Alessandroni, vocalises célestes d’Edda Dell’Orso (venus l’un comme l’autre de l’ensemble choral I Cantori Moderni), cris gutturaux…
Dans une atmosphère évoquant la sauvagerie de l’Ouest, la solitude de grands espaces et les voyages vers des horizons inaccessibles, la musique est là pour parler à la place des héros taiseux chers au genre. Un opéra de la violence aux thèmes mémorables qui passent par toutes les émotions, toutes les couleurs de la poussière et du sang. La complainte à la Dimitri Tiomkin de Mon colt fait la loi, la beauté poignante et tragique du Retour de Ringo, les envolées à la Leone de Colorado, le chœur à l’indienne et les guitares roucoulantes de Navajo Joe, les sifflements sépulcraux du Mercenaire, l’ambiance funéraire du Dernier face à face, la guitare démoniaque et les psalmodies chorales de La Mort était au rendez-vous, les accents presque médiévaux du méconnu mais prodigieux Ciel de plomb, la froideur envoûtante et pourtant nostalgique du Grand silence avec son sitar indien…

Lorsque Morricone se fait plus épique, cela donne La Bataille de San Sebastian, dont le love theme est, avec L’Estasi dell’oro du Bon, la brute et le truand, l’une des pièces les plus sublimes de l’œuvre du compositeur. Le grotesque s’invite dans la dinguerie liturgique d’On m’appelle Providence ou dans le thème irrésistible de Sierra torride (western américain mais avec Clint en mode Leone) et de son cousin 5 hommes armés, et vire au burlesque dans On m’appelle Malabar. Mais l’humour musical, chez Morricone, n’est jamais synonyme de facilité ou de ridicule : c’est encore une fois pour lui l’occasion de signer des mélodies accrocheuses, comme dans Far West Story, où il retrouve les accents d’Il était une fois la révolution avec le thème de Sonny associé à l’affolante Susan George ou dans Un génie, deux associés, une cloche.
Et quand il s’attaque à un hommage quasi parodique tel que Mon nom est personne, Morricone livre l’un de ses thèmes les plus séduisants, plein de tendresse, de jeunesse et de malice (il en reprendra la formule en France pour Le Ruffian), tandis que le reste du score navigue entre emprunts bien sentis à Wagner et musiques de duels n’ayant rien à envier à celles composées pour Leone, d’ailleurs producteur du film. Avec Elmer Bernstein et Jerry Goldsmith, Morricone forme ainsi la Sainte Trinité du western et sa musique transcende les images plus qu’elle ne les accompagne, grâce à un style à la fois romanesque et solaire, viril et tourmenté, agressif et ricanant, aussi révolutionnaire que les westerns zapatistes qu’il illustra avec un entrain de sale gosse indiscipliné.

Mio caro Giallo
Si les partitions composées par Ennio Morricone pour la « trilogie animale » de Dario Argento ne constituent que le sommet de l’iceberg de son œuvre giallesque, elles n’en sont pas moins très représentatives de l’approche qu’il utilisera sur les autres représentants du genre présents dans sa filmographie : un thème pourvu d’une très belle mélodie (faisant à l’occasion intervenir Edda Dell’Orso) maïs rarement repris au sein même du score, lequel déploie quant à lui un style expérimental, atonal et presque bruitiste, avec parfois des accents free jazz. Une musique difficile d’accès, voire pas forcément agréable à écouter sans les images, où percussions, instruments à vent, cordes pincées et claviers désaccordés s’affrontent et se chevauchent, parfois rejoints par des sons électroniques.
La musique est ici uniquement destinée à traduire la peur et la paranoïa, le sadisme et la violence. Elle parle à la fois pour les victimes et pour leurs agresseurs, créant une atmosphère suffocante en contraste total avec les caresses émotionnelles et sensuelles prodiguées par les thèmes principaux. Difficile de ne pas être saisi par la profonde mélancolie des thèmes du Chat à neuf queues et de Mais… qu’avez-vous fait à Solange ?, avec son chant quasi leonien, ou par l’insondable tristesse, presque bertoluccienne, de Je suis vivant !, sommet de la collaboration du compositeur avec le réalisateur Aldo Lado. Morricone retrouvera notamment ce dernier sur Qui l’a vue mourir ?, où le compositeur opte cette fois pour une autre de ses figures de style giallesques favorites : l’air de comptine (également présent dans L’Oiseau au plumage de cristal et Folie meurtrière), histoire de marquer les traumas d’enfance des tueurs ou la mort de fillettes innocentes.

Le travail du m*****o dans le giallo est donc habité par le deuil, la mort et la folie, mais pas que. Élément essentiel du genre, l’érotisme est également de mise à travers des mélodies chaloupées à la volupté troublante (Le Venin de la peur, La Tarentule au ventre noir, Photos interdites d’une bourgeoise) où trompette, soupirs de plaisir et clavecin épousent à merveille les formes généreuses des actrices et leurs regards humides. Parfois, sensualité et tristesse s’étreignent, comme dans Frissons d’horreur. Ailleurs, comme dans Spasmo, un lyrisme presque sacré domine la partition. Versatile dans ses approches, le M*****o peut aussi bien flirter avec son style polar (Journée noire pour un bélier est assez proche de Sans mobile apparent) ou délivrer un score entièrement avant-gardiste (Gli occhi freddi della paura).
On l’aura compris, le giallo chez Morricone est à la fois cérébral et frontal. Le compositeur se consacre au genre de la fin des années 1960 au milieu des années 1970, n’y revenant que vingt ans plus tard à l’occasion du Syndrome de Stendhal pour Dario Argento. Il livre un thème ensorcelant qui ranime les grandes heures de leur collaboration avec ses allures de comptine déviante, son lamento vocal et ses violons tourmentés. Mais cette fois, le thème irrigue toute la partition. Terminons non pas avec un giallo mais avec un fumetti, à savoir Danger Diabolik, merveille de pop psychédélique dont l’espièglerie et la légèreté possèdent un charme enivrant. De quoi regretter que Morricone n’ait pas plus souvent collaboré avec Mario Bava.
French Connection
Très inspirés par le giallo, les polars français Peur sur la ville et Sans mobile apparent permettent à Morricone de prolonger son travail sur les productions italiennes du genre, signant pour l’occasion deux pépites en or massif. Dans Peur sur la ville, il traduit admirablement le mélange de genres auquel se livre Henri Verneuil, avec un inoubliable thème sifflé et l’harmonica pour le côté western du flic tête brûlée joué par Jean-Paul Belmondo, et un staccato rythmique obsédant pour marquer le suspense cher au polar urbain. Le personnage du tueur Minos, lui, se voit associé à des cordes lancinantes et à un air de carrousel.
À l’inverse des giallos purement italiens, le thème principal est souvent repris et soumis à de multiples variations. Même chose pour celui de Sans mobile apparent avec son atmosphère de chaleur écrasante, ses cuivres tordus, sa trompette et son sifflement liés au caractère solitaire du policier cette fois interprété par le regretté JeanLouis Trintignant. Une sorte de ballade languissante et torride qui s’éveille lentement pour évoluer vers une musique plus proche de Peur sur la ville. Lui aussi très marqué par l’influence du thriller transalpin, I… comme Icare met en avant un clavecin et un orgue dans un thème au parfum de pouvoir corrompu et de menace implacable. Si étrangement, Morricone n’a que très peu œuvré dans le poliziottesco, il aura tout de même offert au genre une poignée d’œuvres séminales.
Pour La Cité de la violence de Sergio Sollima, son style se teinte de rock grâce aux wah-wah d’une guitare électrique en feu et à des percussions déchainées. Le compositeur retrouve Sollima à l’occasion de La Poursuite implacable (plus connu sous son titre original Revolver), dont la rythmique très appuyée et les sursauts de cuivres auront une grande influence non. seulement sur La Rançon de la peur, mais aussi et surtout sur le thème d’ouverture des Incorruptibles (William Friedkin, pour sa part, reprendra le thème tel quel dans son téléfilm Les Hommes du C.A.T.).
L’agressivité est donc au cœur des partitions polardeuses de Morricone, mais elle peut aussi céder la place à l’ironie, comme avec la guimbarde d’Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon ou, de façon encore plus assumée, dans Le Carnaval des truands de Giuliano Montaldo, où les coin-coin de la trompette, la batterie et des vocalises écervelées se livrent à une sarabande endiablée pleine d’humour et de soleil. Le Marginal, le plus bis des Bébel des années 1980, fait appel à une guitare basse presque funky et des percussions pop pour sonner plus moderne, tandis que La Proie de l’autostop s’oriente vers le blues avec une couleur typiquement western s’inscrivant dans la lignée de La Bête tue de sang-froid d’Aldo Lado, qui utilisait quant à lui un harmonica sous acide. On est bien loin de la partition terriblement sombre composée par Morricone pour Le Sang du châtiment de Friedkin, ou renaît la profonde tristesse de certains de ses thèmes glallesques avec une sensation de deuil qui contamine l’ensemble du score,

Nous sommes légion
Inutile de se voiler la face : ce n’est pas dans le cinéma fantastique que Morricone s’est montré le plus à l’aise. Déjà, en 1965, sa musique pour Les Amants d’outretombe, avec son romantisme morbide suranné et sans saveur, ne se distingue guère du tout-venant gothique. Ses réussites dans le genre se comptent donc sur les doigts d’une main. Dans L’Exorciste II : l’hérétique, le magnifique thème pour chant et guitare associé à Regan, auquel vient répondre le chant tribal païen du démon Pazuzu, fait preuve d’une telle empathie pour sa jeune héroïne qu’il élève le film bien au-delà du statut de simple séquelle. Son cousin Holocaust 2000 teinte son ambiance de polar d’accents sataniques et sentimentaux.
Pour The Thing, Morricone crée un score minimaliste et angoissant qui épouse la parano ambiante et l’immensité glacée du décor, en symbiose avec la musique de John Carpenter lorsqu’il teinte son orchestre de sonorités et de rythmes synthétiques. Pas assez semble-t-il, puisque le réalisateur de The Fog éjecte la majorité du travail de Morricone, ne conservant que quelques morceaux essentiels pour remplacer le reste par les siens. « Je n’ai eu que très peu de contacts avec John Carpenter » confiait Morricone au magazine Soundtrack ! dans les années 1990, « de sorte que j’ai accepté d’écrire différents types de musiques afin qu’il puise dedans celles qui lui semblaient le mieux convenir à sa conception du film. En réalité, mes morceaux synthétiques n’ont pas grand-chose à voir avec ce qu’il fait. Le seul point commun, c’est qu’ils font appel à du synthétiseur, que j’ai dû utiliser parce que je n’avais jamais travaillé avec lui et que je devais prendre en compte ce qu’il avait fait sur ses autres films. »
Beaucoup moins connu, Wolf prend le risque de mélanger un style très film noir avec saxophone, trompette et accents glamour à une sensation de danger permanent apportée par les violons et des cuivres bestiaux traduisant l’animalité des personnages, le tout rehaussé par un motif synthétique malheureusement un peu à côté de la plaque. Il n’empêche : Wolf reste l’un des scores les plus intéressants de la période nineties de la carrière hollywoodienne de Morricone. C’est aussi à cette époque qu’il signe sa dernière B.0. en date pour Argento, à savoir Le Fantôme de l’Opéra, dont le romantisme plaintif tente de donner un peu de consistance à l’histoire d’amour impossible du film.

Epic Ennio
S’il est préférable d’oublier poliment les expérimentations électroniques du compositeur dans la science fiction (L’Humanoïde, la version italienne de la série Cosmos 1999 dont trois épisodes sont assemblés pour une diffusion en salles), il s’illustre en revanche avec superbe dans l’heroic fantasy avec Kalidor : la légende du talisman : un thème principal propulsif, un motif d’action épique directement hérité de Conan le barbare (et pour cause, le film est une suite non officielle de Conan le destructeur), pour une partition dont le lyrisme renversant épouse à merveille la force et la beauté de son héroïne Red Sonja.
Morricone essaiera sans grand succès de retrouver cette formule magique sur Hundra, amusante bisserie où Brigitte Nielsen cède la place à la non moins sculpturale Laurene Landon, mais la musique se borne à du recyclage bas de gamme de Kalidor auquel vient s’ajouter un thème pseudo classique qui ne semble être là que pour rehausser la pauvreté esthétique du film. Enfin, même si le film appartient plus au cinéma d’aventure qu’à l’imaginaire, impossible de ne pas évoquer la beauté nautique d’Orca, dont le thème résume admirablement la splendeur de l’océan et la souffrance de son personnage principal, une orque lancée après un pêcheur pour venger la mort de sa compagne et de sa progéniture.

De la mer au désert, il n’y a qu’un pas que Morricone franchit allègrement dans la production Cannon Sahara et la série Le Secret du Sahara. Malgré des intrigues ouvertement inspirées par les aventures d’Indiana Jones, le M*****o préfère évoquer la chape de plomb du soleil, les dunes à perte de vue et les sentiments amoureux des personnages plutôt que de célébrer l’action et les péripéties à outrance. Ces partitions hypnotiques aux mélodies puissantes, baignant dans de discrètes couleurs locales, n’ont donc pas grand-chose à voir avec du John Williams. Le Trésor des quatre couronnes et L’Île sanglante se montrent bien plus paresseux avec leurs thèmes passe-partout interchangeables même si, entendons nous bien, la musique reste fort agréable à l’oreille.
Si on ne devait garder qu’une seule musique d’aventure d’Ennio Morricone, ce serait sans aucun doute celle de Marco Polo, qui enchaîne les morceaux stupéfiants de beauté et de souffle épique dans un long poème symphonique surgi tout droit de la Renaissance. Avec John Barry et John Williams, Morricone reste l’un des plus grands mélodistes de l’Histoire de la musique de film et son œuvre immortelle n’a pas fini de conquérir les cinéphiles mélomanes. On envie ceux qui ne l’ont pas encore découverte…
Par Cédric DELELÉE
-
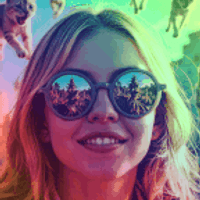 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
S'inscrire Se connecter

