[Actualité Vidéo] Ebola Syndrome
-

À l’heure où la Chine menace de faire disparaitre les branches les moins «idéologiquement alignées» du patrinoine cinématographique hongkongais, Spectrum Films fait acte de résistance. L’éditeur français nous gratifie d’une splendide édition du rejeton terminal de la classification Category III : Ebola Syndrome de Herman Yau, fascinante capsule des années 1990 devenue emblème de la radicalité d’antan.
Depuis ses premiers travaux comme metteur en scène, à l’orée des années 1990, Herman Yau n’a jamais cessé de tourner. Il sort toujours entre un et cinq films par an, malgré les montagnes russes traversées par l’industrie hongkongaise au fil des décennies. Des polars, des comédies, des drames sociaux, des blockbusters, des films d’arts martiaux, de triades, et bien évidemment des productions extrêmes tombant dans la fameuse Category III, grande foire aux atrocités et aux déviances créée par la refonte du système de censure local à la fin des années 1980.
Sa filmographie riche de plus de 70 titres est celle d’un véritable mercenaire, hyperactif et particulièrement complexe à circonscrire. C’est ce que confirme Arnaud Lanuque, envoyé spécial en direct de Hong Kong à qui l’on doit la moitié des bonus inédits du Blu-ray d’Ebola Syndrome que sort aujourd’hui Spectrum Films.
Yau est le touche-à-tout ultime. Il a des standards très particuliers, il me disait en interview qu’à partir du moment où il y a un élément dans le scénario qu’il trouve intéressant, même si tout le reste est à jeter, il est prêt à le faire. C’est sa philosophie. Et il ne se restreint pas à la mise en scène, il a signé de nombreux articles dans des magazines. Il est en outre l’auteur de la thèse de référence sur la censure à Hong Kong, c’est un docteur honoris causa.
Bien avant d’accéder à ce titre prestigieux, Herman Yau se forme sur le tas, d’abord comme directeur de la photographie. Ses toutes premières réalisations se fondent indistinctement dans la masse de l’effervescence hongkongaise du moment. No More Love No More Death (1993), préquelle du With or Without You de son mentor Taylor Wong, verse trop dans l’esthétisation poseuse pour convaincre, ou faire oublier sa bande originale envahissante. Best of the Best (1992) mélange drame bancal, romance avec galoches sous la pluie et polar mou pour s’achever en heroic bloodshed pompier. Don’t Fool Me (1991) propose une variation pas franchement galvanisante sur le thème d’Un fauteuil pour deux avec Andy Lau et Tony Leung Chiu Wai, mais possède un atout de taille: la présence, en second rôle cabotin, d’un Anthony Wong aux cheveux longs, au sourire goguenard et au regard dément. Herman Yau exploite son potentiel dans Taxi Hunter (1993), où Wong venge la mort de sa femme enceinte en massacrant les chauffeurs de taxi indélicats (et leur clientèle avec), puis le starifie la même année dans le mémorable The Untold Story.

EBOLA ORIGINS
Le script de The Untold Story s’inspire vaguement d’un fait divers survenu en 1985 à Macao (le massacre d’une famille propriétaire d’un restaurant), dont les scénaristes prennent pour acquis certains éléments relevant de la légende urbaine (l’assassin aurait fait manger des bouts de ses victimes aux usagers du lieu). Cette histoire sordide est l’excuse parfaite pour verser dans une méchanceté totale, où le personnage d’Anthony Wong n’apparaît finalement que comme le produit de son environnement. Torturé par des flics ineptes et des compagnons de cellule sadiques, il finit par avouer ses crimes dans un flash-back traumatisant. L’acteur laisse éclater tout son potentiel, tant en équarrisseur qu’en détenu humilié.
Son visage est pris de spasmes, se fend des pires sourires jamais captés par une caméra. Il bondit de victime en victime avec enthousiasme, gourmandise, comme un démon replet. En tout autres temps et pays, ce genre de performance vous grille à vie, pousse à se retirer dans une grotte reculée jusqu’à la mort. Dans le monde merveilleux du cinéma hongkongais de cet Âge d’Or, Anthony Wong est couronné du Prix d’interprétation Masculine aux HK Film Awards de 1994 et accède à la célébrité. Herman Yau s’en retourne de son côté à sa productivité stakhanoviste. Le gentillet Cop image (1994) déçoit malgré son Anthony Wong binoclard fan de polars américains. Don’t Shoot Me, l’m just a Violinist et Fearless Match (1994) amusent autant qu’ils ennuient. Si City Cop (1995) laisse augurer d’une forme de retour en grâce, All of a Sudden (1996) douche ces maigres espoirs. Cette réappropriation hongkongaise des thrillers érotiques américains d’alors, classée Category I, témoigne néanmoins d’une curieuse rémanence de la Sale ambiance de The Untold Story. Personnages veules et manipulateurs, sexe crapoteux, musique aux riffs de guitare bizarrement agressifs: Herman Yau plante les graines de son classique à venir.
En 1995, le producteur Wong Jing, margoulin s’il en est, couche sur une feuille de papier recto verso l’une des innombrables idées qui lui passent par la tête : un mélange entre The Untold Story et Alerte ! de Wolfgang Petersen, blockbuster US de 1995 où une petite ville américaine est frappée par un virus manifestant tous les symptômes d’Ebola, mais que les scénaristes ont baptisé Motaba. Par pudeur, sûrement. Wong Jing lance Herman Yau sur le coup, lequel lui recommande son amie Chau Ting, avec qui il avait aimé collaborer sur No More Love No More Death. La scénariste s’acquitte de la tâche dans les impossibles délais impartis, au plus grand ravissement de Wong Jing, éberlué de lire « un texte aussi horrible de la plume d’une femme aussi élégante », dixit l’intéressée dans son interview pour l’édition Spectrum.
Ebola Syndrome est tourné à toute berzingue, selon les standards de l’époque, en 17 jours - étape en Afrique du Sud comprise. Le marché de niche des œuvres déviantes labellisées Category III s’étiole peu à peu, le film sera son chant du cygne zénithal, une monstruosité à peine croyable découverte par beaucoup de spectateurs internationaux dans des VCD importés à l’image dégueulasse et aux sous-titres envahissants (attributs techniques qui contribuaient à rendre l’expérience de visionnage encore plus interlope). La légende est en marche, même si ses maîtres d’œuvre sont loin de s’en douter.

CRACHE TEST
Sa réputation sulfureuse de match retour belliqueux de The Untold Story éclate dès sa sortie, relayée en France par les défricheurs taquins de HK Magazine, mais le film n’impressionne guère le box-office local. L’apogée de la Category III se joue devant un public anesthésié et blasé. La renommée du film grandit surtout à l’étranger, d’abord comme un secret d’initiés à la fois honteux et jubilatoire. De nombreux cercles cinéphiles comptent en leur sein des aventuriers de l’extrême prenant un malin plaisir à raconter ses scènes les plus atroces, du massacre inaugural de Kai à la vision hallucinante d’un Anthony Wong possédé et -crachant du sang sur des badauds en hurlant « Ebola ! _Ebola ! », en passant par toute une série d’abjections filmées plein cadre.
Des exactions à peine raccourcies de deux minutes cradingues pour la sortie en salles. Le Blu-ray de Spectrum Films propose à la fois ce montage censuré et la version intégrale, sur deux disques séparés. Dans sa lapidaire introduction pour la version écourtée, Herman Yau a cette expression assez vague quand il revoit Ebola Syndrome, il se rappelle « ce que c’est que d’être jeune ». Pour en savoir plus, mieux vaut donc se tourner vers le vieil entretien (toujours dans l’édition Spectrum) accordé par le réalisateur et un Anthony Wong particulièrement mal luné: tirant la tronche derrière des lunettes noires, l’acteur déclare avoir fait le film juste pour le fric et disparaît du cadre au bout de cinq minutes. Hilare face aux réactions de son compère, Yau tente néanmoins de répondre le plus sincèrement possible.
Selon lui, Ebola Syndrome a été réalisé dans un élan purement impulsif, dans le flot de son habituel rythme de travail frénétique. Ses sous-textes relèveraient d’une somme d’intentions inconscientes de sa part et de celles de Wong Jing, Chau Ting et Anthony Wong. Le commentaire audio, en date de la fin des années 2000, en apprend plus. Le comédien y apparait plus détendu, content de partager ses souvenirs avec son camarade Herman Yau. Les deux hommes relèvent des erreurs techniques accentuées par la qualité d’image, pointent des maladresses que l’expérience ne leur ferait plus commettre. Ils s’étonnent de la violence du film, s’amusent de sa complaisance tout autant que de la résonance qu’il a su trouver auprès du public étranger. Ils ne manquent pas de répéter qu’une telle production ne pourrait être mise en scène aujourd’hui.
Pourtant, à la même époque que celle de l’enregistrement de ce commentaire, Yau réalise Gong Tau (aussi connu sous le titre Voodoo), un film d’horreur glauque et sale pensé comme une réminiscence des films de magie noire dont le cinéma hongkongais s’est fait une spécialité entre les années 1970 et l’arrivée officielle de la Category III. Sexe violent, cadavre dégueulbif de nourrisson, représentation du Leyak indonésien (la fameuse tête volante avec les entrailles pendantes), Herman Yau ne ménage pas ses efforts pour choquer le spectateur de 2007… mais le feu sacré n’y est plus. La réalisation, le script, la photo et le montage souffrent tous du même manque d’inspiration, de la même volonté de sucer la roue du torture porn à l’américaine et de son esthétique, ou plutôt de son absence d’esthétique. C’est peu dire que Mark Cheng n’est pas Anthony Wong. Pire que tout, Gong tau ne raconte rien, si ce n’est la difficulté de réaliser un tel film après la Rétrocession de Hong Kong à la Chine.


BRIS BURNAIRE
La même gymnastique de pensée se devine dans les propos de Herman Yau, de Chau Ting et même du chorégraphe James Ha dans les bonus du Blu-ray. Pour des raisons évidentes, les interviewés marchent sur des œufs et ne prêtent aucune intention discursive à Ebola Syndrome, dépeint au fil de l’eau comme un petit film mal élevé montrant, de façon certes exagérée, la revanche d’un homme exploité. La réalité est bien évidemment toute autre. Si l’acidité sulfurique du film n’a rien perdu de sa corrosivité 25 ans après sa sortie, c’est bien parce qu’il est l’expression d’une [censored] colère.
Ebola Syndrome est le film du ras-le-bol, du rejet de l’Humanité, du lâcher-prise, de l’agressivité et du racisme généralisés, de l’exploité transformé en barbare, de l’oppression au carré. La Category Ill enjoignait à coucher sur pellicule les pires atrocités afin de secouer un public désireux d’extérioriser ses craintes d’un avenir incertain ? En voici l’excroissance ultime, ordurière et vulgaire au dernier degré, synthétisée par la réplique préférée de Kai, « Vous me cassez les couilles », annonciatrice d’une ignominie imminente.
Pour Amaud Lanuque, « le film reflète le côté hard rocker contestataire de Herman Yau. C’est une manière d’assouvir toutes les frustrations d’une fraction de la population, parce que les conditions de travail à Hong Kong ne sont pas vraiment joyeuses. Tu es obligé de rester au bureau tant que tes supérieurs sont là, tu as peu de jours de congés, tu n’est pas forcément bien payé, sans filet social. Et là, tu as ce personnage qui se fout de toutes les règles, qui fout des roustes à ses patrons et les assassine. C’est un exutoire absolu. »
Les victimes de Kai sont aussi bien occidentales que chinoises, colons, expatriés, locaux, allez tous vous faire foutre. Dans la continuité des œuvres les plus corsées de Herman Yau depuis Taxi Hunter et The Untold Story, les forces de l’ordre font preuve d’un degré de compétence tout relatif. Les gars en bleu, tant du côté sud-africain qu’hongkongais, mettent un temps fou à additionner 1+1, interviennent trop tard et n’importe comment. Il en va de même dans The Sleep Curse, le dernier Category III réalisé par Yau en 2017. Interrompu en plein boulottage de cadavre, Anthony Wong y est accompagné vers la sortie par deux agents. Il prend le temps de cracher un glaviot sanguinolent sur le sol, sourire en coin.
De temps à autre, pour qui veut bien le voir, le binôme retrouve sa jeunesse, dont Ebola Syndrome demeure l’étendard souillé de sperme, de pus, de sang et de vomi.
Par François CAU
Merci à Antoine Guérin et Arnaud Lanuque -
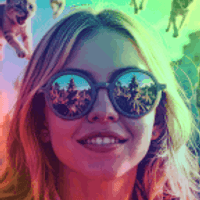 undefined Violence a fait référence à ce sujet sur
undefined Violence a fait référence à ce sujet sur


